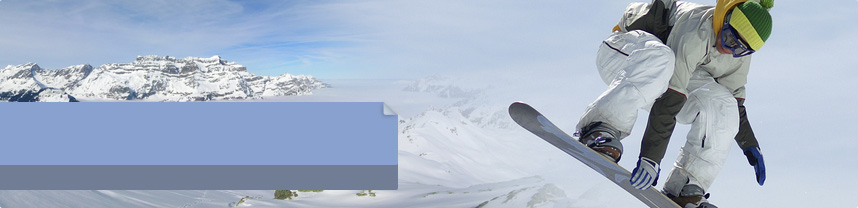Mémoires d’un compagnon du devoir
Dans les tribulations du XXe siècle
Rédigé par Pierre André DOUX, menuisier-ébéniste, au château des métallos de la CGT, à Ambroise-Croizat
Le Copeau©1970
A Roger Donnart
Fusillé le 16 décembre 1941 durant le Blocus de Djibouti
Pour soutien aux Forces Françaises Libres
(Anciennement Côte Française des Somalis)
©Tous droits réservés, 1956
Préface
Les mémoires de mon père ont été rédigées en temps et lieu susmentionnés. Il s’agit d’un récit exceptionnel sur le tragique déroulement de l’Histoire de la première partie du XXe s. et de son impact sur un destin qui se voulait ordinaire. De la veille de la Grande guerre à la fin de la Seconde guerre mondiale, les événements se succèdent, ponctués de rencontres improbables : en 1910, c’est Lénine qui se promène en Île-de-France en compagnie d’amis communs ; en 1936, sur le Koutoubia qui le ramène en France, c’est l’épouse éplorée du mécanicien qui vient de périr avec Mermoz alors aux commandes de l’aéropostale, dans le golfe Saint-Paul au large du Brésil ; en 1935, alors qu’il est hospitalisé, c'est la visite de Monseigneur Capra, envoyé de Sa Sainteté Le Pape en mission en Afrique Française, sans oublier Henry de Monfreid, en 1942, dans l'enfer du Blocus de Djibouti...
Ces pages sont restées longtemps dans l’oubli, dans les fonds de tiroirs. Ma fratrie et moi-même, pour des raisons fort différentes, ne souhaitions pas les en sortir. Disons à la décharge de certains – dont je suis – que mon père ne nous a guère laissé de bons souvenirs. Voilà qui est dit. Ces mémoires ont donc connu un long sommeil, car une fois le chapitre d’une enfance malmenée clos, pourquoi revenir sur ce récit qui nous avait été martelé et asséné tout au long de notre enfance… avec, toutefois, des divergences éloquentes sur lesquelles je reviens plus loin.
Si finalement, j’ai rompu la phase de l’oubli, c’est le constat que ma fratrie ne s’y intéresserait jamais, quand le récit va bien au-delà de l'expérience paternelle, même s'il explique par voie de conséquences, le chemin accidenté, misérable et désespérant, emprunté par notre famille. Les lieux visités sont emblématiques d'une époque - celle des deux guerres mondiales, de la pandémie de grippe dite « espagnole » qui fit plus de morts que les tranchées, de la Grande crise de 1929, mais aussi celle de la colonisation qui tire à sa fin, avec en toile de fond La Guerre du désert de 39-43.
Quelques commentaires : avant de prendre connaissance des mémoires de mon père, je n'avais que des souvenirs d’enfance éparpillés depuis longtemps dans ma mémoire. Toutefois, plusieurs passages de ce récit sont en porte-à-faux avec ces souvenirs. Exemple, le décès de sa première femme ; tel que relaté par mon père, celle-ci aurait perdu la vie en 1939 dans les bombardements allemands sur Toulon, alors qu’elle fuit une France dans la débâcle. Cependant, ici, réfugiée du Blocus de Djibouti à Madagascar, elle décède à l’Hôpital colonial de Tananarive dans des circonstances troublantes. En effet, tout d’abord la femme est solide. Ensuite, mon père, connaissant parfaitement la région de l’Abyssinie à l’Éthiopie puisqu’il y a travaillé assez longtemps, est celui à qui l’on s’adresse discrètement pour trouver le chemin, puis les boutres, qui permettent de rejoindre les Forces Françaises Libres (FFL), les plus proches étant de l’autre côté de la Mer Rouge, du côté d’Aden. Y a-t-il eu trahison ?
Je constate par ailleurs l’absence de certaines marques de fierté, pourtant abondamment relatées durant notre enfance. L’un des faits concerne le général Le Gentilhomme, FFL ; il aurait serré la main des rescapés du Blocus de Djibouti, dont mon père – communiste –, mais cela ne figure pas ici. Autre fait, antérieur celui-là : en pleine guerre de 14-18, au large des Dardanelles, il aurait été atteint de dysenterie à bord du cuirassé Patrie ; dans ces circonstances dramatiques, ses chances de survie étaient plutôt minces. Toutefois, ici, l’incident précède l’engagement volontaire de 14-18 et on le retrouve dans la marine marchande, certes en temps de guerre, atteint non pas de dysenterie, mais de typhoїde et hospitalisé à l’hôpital de Nantes. Toutefois, là encore, parmi tous les papiers conservés au fil de sa vie – plusieurs classeurs – apparaît bien un certificat de maladie de l’hôpital de Nantes concernant une typhoїde, mais ce certificat date de 1934.
Enfin, j’ai supprimé le nom des personnes visées par ses accusations (ainsi que les accusations) – qui ici pleuvent – et la plupart des épithètes de « traître » et de « collabo » qui émaillent son récit pour une question d'éthique, mais aussi parce qu’il y a ambigüité dans le récit de mon père. Quelques exemples : si celui-ci relate l’accueil à bras ouverts du gouvernorat de Madagascar – officiellement vichyste - lorsqu’il est évacué de Djibouti et embarqué sur le navire ayant pour mission de forcer le blocus, le lecteur quant à lui peut s’en étonner. En effet, outre les malades, ce navire transporte néanmoins tous les « indésirables », à savoir des Français soupçonnés de liens avec la résistance, des communistes et autres suspects. Autre fait susceptible d’étonner le lecteur : parmi les gens qu’il rencontrera à Madagascar, l’entrepreneur et directeur des Pompes funèbres de Tananarive lequel a évidemment pignon sur rue. Pourtant, il porte un nom juif.
Outre ces contrastes avec la Métropole, nous savons que lorsque Leclerc fut envoyé aux colonies par le général de Gaulle pour sonner le rassemblement des troupes, il le fit avec plus de volonté que d’armes face aux gouverneurs. Ainsi commença La Guerre du désert. En 1941, à la tête de la Coloniale et des Tirailleurs, celui qui deviendra le général Leclerc lance l’offensive sur le fort de Koufra dans le désert de Libye contre une garnison italienne bien armée. Koufra est la première victoire vers la Libération. Mais si Koufra créé la surprise, c'est Bir Hakeim en 1942 qui sous le commandement de Kœnig redonnera définitivement espoir aux affamés du Blocus de Djibouti. Défendu par trois mille sept cents hommes, ce sera la victoire de Bir Hakeim face aux troupes du maréchal Rommel pourtant fortes de trente mille hommes. Bir Hakeim sera décrit comme « le fort Vauban du désert », « l'imprenable ». La France vient de relever la tête.
Nota : Mis à part les suppressions susmentionnées, le texte est livré en l’état, dans sa rédaction originale. Nous déclinons toute responsabilité quant au contenu de ces mémoires.
Je suis né le 22 février 1898 à Villeneuve-le-Roi, Seine et Oise. Je suis l’aîné de six enfants, orphelin de père à neuf ans en 1907 ; ma mère remariée, j’ai un beau-père. Mes parents et grands-parents paternels possédaient des chevaux, des voitures de toutes sortes – en ce temps, il n’existait pour ainsi dire pas d’automobiles – des terres et des maisons. J’ai reçu mon certificat d’étude à l’âge de douze ans dans mon canton de Longjumeau. Mon oncle, Charles Doux, artiste musicien aux Folies Bergères, puis au Châtelet, ainsi que mes parents, m’avaient fait apprendre la musique, le violon, études abandonnées en 1910. J’ai repris mes études après la guerre de 14-18 chez monsieur M., demeurant à Ablon près de mon domicile. Monsieur M. était violoniste à l’Opéra de Paris, doyen des professeurs au Vieux Conservatoire national de musique et doyen des membres de la Société des concerts du vieux Conservatoire national de musique. J’ai été son élève chez lui à Ablon pendant trois ans.
En 1910, sous la pression, un peu, de mon beau-père, je quitte l’école et je suis apprenti menuisier pendant trois ans. En quatre ans, j’ai appris le métier entièrement à la main sans jamais avoir vu une seule machine à bois. Je suis fier de rapporter mes premières paies, des quinzaines d’environ soixante francs, oui, mais c’était des pièces de cinquante centimes, d’un ou deux ou cinq francs en argent et mes pièces de dix et de vingt francs étaient en or. J’attachais ma paie dans mon mouchoir. Un grand bifteck de cheval de premier choix me coûtait trente centimes, un litre de bon vin, trente centimes, une bonne paire de chaussures, cinq francs. Il y avait partout des logements libres ; on pouvait très facilement déménager à la cloche de bois.1 Nombreux sont les locataires qui ne payaient pas leurs loyers à mon grand-père dans ses maisons de la rue du Pont à Villeneuve-le-Roi. Mon grand-père, Philibert Doux, ne les a jamais inquiétés. Il leur disait « ça sera pour quand vous pourrez payer », mais c’était rare qu’ils le pouvaient ou qu’ils le voulaient.
Août 1914, la guerre éclate. Mon patron avec deux compagnons sont mobilisés. L’atelier est fermé. Je travaille alors avec mon beau-père qui n’est pas mobilisé étant chef d’une famille de six enfants. Tous ses commis ont été mobilisés et je tombe bien pour les remplacer. Je fais le déménageur de gens riches qui quittent leurs belles villas d’été pour habiter de beaux appartements dans Paris. Je grimpe les étages avec des charges qui dépassent les cents kilos, souvent un piano. Je vais à la gare d’Ablon charger et livrer les colis, les caisses, les tonneaux de vin que je descends en cave, culbute, mets en chantier, etc. Deux fois par semaine, à Ablon et à Villeneuve-le-Roi, avec un grand tombereau avec des rehausses, je fais toutes les rues, je jette les poubelles sur le tombereau et mon beau-père les vide et me les renvoie. Parfois, il saute à terre en bougonnant pour m’aider à soulever les trop lourdes. Tard le soir et tôt le matin, il faut être aux écuries, à soigner les chevaux avant et après nous.
Mon beau-père était sans méchanceté, mais dur au travail. Il était fort et solide comme un rocher et les chevaux, comme nous tous, devaient endurer et résister comme lui. Ma mère, elle-même, au travail était aussi dure que lui et remplaçait n’importe quel homme pour les travaux les plus durs. Elle est restée légende dans la mémoire des très vieux d’Ablon, de Villeneuve-le-Roi et de la contrée. Mon beau-père me vexait souvent à table aux repas, en me disant que je ne serais jamais capable de gagner mon pain. Il me lançait aussi d’autres pointes qui touchaient la fierté d’un gosse de seize ans et demi que j’étais.
.jpg)
Villeneuve-le-Roi, Seine-et-Oise, alors un village, aujourd’hui banlieue de Paris
Sur les routes de France
Le 14 septembre 1914, avec mon petit baluchon, un casse-croûte, une pièce en argent de un franc dans ma poche, je pars seul à pied pour gagner ma vie par mon travail. En ce temps, il n’existait pas de Sécurité Sociale ; je n’avais pas de numéro matricule qui nous suit partout. J’ai travaillé dans de petites fermes de la vallée de la Loire. J’arrive en novembre 1914 à Saint-Nazaire-Penhoët où je travaille à l’atelier du bois et sur les navires des grands chantiers de construction navale. Je suis payé au-dessus du tarif ; je n’ai pas dix-sept ans et je suis payé au tarif des dix-huit ans. Les canards,2 des Briérons, sont jaloux de moi « le Parisien », et, sournoisement, quand ils sont en groupe, je suis nargué. Un soir, rue de Lille à Penhoët, je suis suivi par un canard plus âgé que moi et qui gagne moins. Il me bouscule et nous nous battons. Tout est désert par une nuit noire. Nous roulons dans des mares de boue faites de poussière de charbon. Nos sabots de bois, à un franc cinquante centimes la paire, nous sont sortis des pieds. J’en sens un sous ma main et avec je cogne dur sur le crâne de mon canard. Assommé, il me lâche et je cours dans ma pension non loin de là. Les cinq pensionnaires m’attendaient pour souper. Ils me regardent tous ahuris : j’étais blessé à la figure, je saignais du nez, ma veste bleue de travail était complètement déchirée et couverte de boue. La patronne, une Morbihannaise d’Auray, me questionne et je lui dis : « J’ai été attaqué par un canard, il est là, dehors, tout près d’ici ». Tout le monde de la pension sort et regarde le canard ensanglanté aussi, plein de boue, cherchant ses sabots. Le lendemain, j’en fis part à mes chefs Nazairiens qui, par le chef d’atelier, monsieur L., eurent la consigne de passer un bon savon à mes jaloux de canards qui ensuite me fichèrent la paix.
La Compagnie Générale Transatlantique en 14-18
Fin avril 1915, je prends le train et je m’en vais au Havre. J’ai dans ma poche des économies et un plus gros baluchon. Ce grand port, ce trafic en pleine guerre, les navires de toutes sortes, de tous pays, depuis les grands quatre mâts à voiles carrées de la Compagnie Borde, jusqu’aux plus modernes paquebots, tout ça m’émerveille et j’envie les hommes qui font partie de ces équipages et qui partent au loin pour des voyages de deux à trois mois avant de rentrer au port. Les grands voiliers passent au Cap Horn ou au Cap de Bonne Espérance. Ce sont des campagnes de douze à dix-huit mois. J’ai passé mes dix-sept ans et j’ai un grand désir de voyager, de connaître l’Amérique, de passer les tropiques et l’équateur. Je me renseigne et j’apprends que toutes les compagnies de navigation manquent de personnel et qu’il est assez facile de trouver un embarquement. Je me présente à l’agence de la Compagnie Générale Transatlantique, muni du consentement de ma mère, qu’elle avait enfin accepté de m’envoyer après me l’avoir refusé d’abord en m’exposant les périls en pleine guerre et sa responsabilité à elle. Après avoir passé la visite sanitaire, je suis embarqué en qualité d’aide-cuisinier aux cuisines des premières classes à bord du paquebot Haïti, à quatre-vingts francs par mois, habillé, couché dans un bon lit avec des draps. Je mange ce qui me plaît le mieux ; le pâtissier est un copain et je fais honneur à ses meilleurs gâteaux. Pour les meilleurs vins je ne suis pas tenté ; je n’aurais que l’embarras du choix que ce soit Bordeaux ou Champagnes, etc. Tous les soirs après le service, le chef d’office envoyait aux cuisines de quoi garnir la belle cave d’un particulier. Et ça n’était pas perdu, car dans l’équipage il y en a qui faisait du trafic, avec échanges en douce aux escales.
Le 9 mai 1915, c’est le torpillage du grand Lusitania. Le paquebot Haïti appareille et quitte Le Havre pour une ligne de quarante-cinq jours avant de rentrer au port, en passant par Bordeaux ou Saint-Nazaire, l’Espagne, les Antilles, le Venezuela et la Colombie à Cristobal, puis le canal de Panama. Après quatre traversées sur cette ligne, le Haïti est affrété par la Compagnie Sud-Atlantique dont plusieurs navires ont été coulés vers les Dardanelles et Salonique. Le Haïti fait Lisbonne au Portugal, Dakar – où l’on faisait le ravitaillement en charbon – le Brésil à Bahia, Rio de Janeiro et Santos, l’Uruguay à Montevideo, et l’Argentine à Buenos Aires où l’escale durait le plus longtemps – quinze ou douze jours – comme dans toute tête de ligne, pour réviser les machines.
Nous rentrons à Bordeaux le 1er janvier 1916 ; je quitte le Haïti et je vais à Villeneuve-le-Roi surprendre ma famille qui ne m’attend pas, ne connaissant pas exactement où je suis. En entrant, ma mère, surprise, me saute au cou en me serrant et disant « mon André ». Mon frère et mes quatre sœurs étaient tous joyeux. C’est l’unique fois où ma mère m’a serré dans ses bras.
A table, aux repas, mon grand-père paternel, Philibert, né le 16 avril 1827 à Pouc, dans la Nièvre, me parle avec une voix que je ne reconnais plus. Il a quatre-vingt-neuf ans. Il n’a jamais de sa vie été malade et, à mon départ en 1914, il était solide, mais dès le début de la guerre, tous ses petits-fils, mes cousins, ont été tués au front. Il en ressent un grand chagrin. Il est heureux de me voir ainsi que moi qui l’aime tant. Il me rappelle mon père.
A peine quinze jours passés chez moi, vers le 15 janvier 1916, je sens la froideur de mon beau-père à mon égard. Je n’ai pas la tête dure et je comprends que je suis de trop dans la famille. Il est fâché avec la famille du côté de mon père et moi je reste bien avec tout le monde. Je fais mon baluchon, j’embrasse bien mon grand-père, je prends le train à Saint-Lazare et en route pour Le Havre. Quelques semaines plus tard, par une lettre tardive, j’apprenais que mon brave grand-père, Padoux, comme nous l’appelions tous, était mort le 21 janvier 1916 et inhumé.

L'Amicale, Fanfare de Villeneuve-le-Roi
Mr Philibert Doux (Padoux), grand-père de Pierre André Doux
Le Havre, quai de Videcoq
Pendant mon court séjour au Havre, je vais travailler sur les quais, dans les docks. J’ai dix-huit ans et je suis fort. Je suis docker. Dans la menuiserie, j’aurais gagné de cinq à six francs par jour et en tant que docker, je gagne huit francs par jour. Je travaille honnêtement. Je me souviens des conseils de ma mère. Un jour, une bande de garnements me sollicite pour prendre part avec eux au vol facile et sans risque de gros lingots d’étain sur un quai. C’est pas la peine de compter sur moi et je les laisse opérer sans m’occuper d’eux. C’est en pleine guerre et les marchandises arrivent et s’entassent partout. Il n’y a plus de place sur les quais. Les voleurs ne savent plus où donner de la tête.
Mais moi, de temps à autre, le soir, je vais au grand théâtre et le plus souvent aux Folies Bergères où un soir je fais la connaissance d’une jeune femme élégante qui me propose de l’accompagner et d’aller dormir chez elle. Le lendemain matin, de bonne heure, je pars me changer à mon hôtel et je file à mon travail dans les docks. Ses services avaient été gratuits et elle m’espérait le soir. Encouragé par la gratuité – et la chair est faible – j’étais le soir au rendez-vous, chez elle. Cela dura quelques jours, puis une nuit elle me dit : « Je vais te présenter à des amis ». J’étais dans un lit, dans un angle, dans une alcôve fermée par des grands rideaux qui tombaient du plafond. Tout d’un coup, les grands rideaux s’ouvrent en s’écartant et elle dit : « Je vous présente mon homme ! » Et un homme et une femme m’ont serré la main. Nous bûmes une bouteille de Champagne et, à pas de loup, ils repartirent. L’homme et la femme étaient sans chaussures et marchaient en chaussettes. La femme était une prostituée de la rue Bazan, du quartier Saint-François-Notre-Dame, et l’homme, son marlou, son souteneur, un déserteur caché dans les greniers et les caves de ces quartiers.
Après cette rencontre, mon amie devint exigeante. Elle m’imposa de demeurer avec elle, chez elle. Je lui promettais toujours, mais je gardais ma chambre à l’hôtel du quai de Videcoq. Elle me montrait toute sa garde-robe très bien garnie. Elle m’acheta du linge, le plus fin, le plus cher. Elle m’emmena rue de Paris chez un grand tailleur et me fit faire un complet sur-mesure que je portais avec le borsalino. Tout cela était rangé dans sa garde-robe. Elle prenait les mercredis comme jours libres et ces jours-là elle ne voulait pas que j’aille à mon travail. Nous sortions tous les deux. Habillé tout de neuf, je ne ressemblais plus à un docker. Elle avait toujours soin d’avoir, placés dans mes poches, portefeuille et porte-monnaie bien garnis. Je dépensais sans compter. Quand il n’y en avait plus, elle en remettait et il y en avait toujours. Nous allions souvent à Sainte-Adresse aux Pavillons bleu, jaune et rouge, dans des restaurants ou des boîtes de nuit. Après ces randonnées, tout mon linge et tous mes vêtements étaient rangés chez elle et je reprenais le collier d’ouvrier.
Je savais bien qu’elle était prostituée. Tous les navigateurs, des milliers de militaires Anglais, Canadiens etc. font escale au Havre. Elle est jeune et belle fille. Elle ramasse des sommes considérables qu’elle a plaisir de me faire compter avec elle. Mais un jour, elle se fâcha contre ma promesse évasive de venir définitivement chez elle, vivre avec elle. Elle m’imposait de ne plus travailler du tout, d’être tout à elle et ne fréquenter que ses amis. Voyant mon hésitation, elle me menaça de me tuer ou me faire descendre. Je la savais capable de le faire, mais je l’aimais bien et elle le savait. C’est étonnant, mais c’était ainsi.
A bord du Mont-Ventoux
Les bons conseils et mises en garde de ma mère me revenaient toujours à la mémoire. Je pris la décision de rester dans le bon chemin et, pour éviter tout scandale, de disparaître. Elle avait vingt-deux ans et toutes les possibilités de me retrouver dans le Havre. Il fallait que je parte. Je me présentai à l’agence de la Compagnie Générale Transatlantique. J’acceptai le premier embarquement disponible et dans la même journée, je passai la visite sanitaire et toutes les formalités au bureau de l’Inscription Maritime, quai de Videcoq, près de mon hôtel. Le lendemain matin, j’embarquai à mon nouveau poste à bord du cargo Mont-Ventoux, en qualité de soutier, faisant partie du deuxième quart, de dix à deux heures, le plus pénible des trois quarts ; service en trois quarts de jour et trois quarts de nuit, les quatre heures de quart de jour et en plus une heure de nettoyage-travail sur les machines. Les quatre heures de nuit étaient purement aux soutes à charbon, chaufferie et vidage d’escarbilles. Ce grand cargo comprend deux énormes chaudières Belleville à trois foyers chacune. Il n’a rien de moderne ; vieux système ; le charbon est apporté à la manne,3 le vidage d’escarbilles au treuil à vapeur par une manche à air. Par tempête, ça cogne partout et il en tombe sur le chauffeur en bas qui rouspète déjà du manque de charbon pour charger les foyers. Le chef de quart arrive des machines en vociférant que la pression baisse. Il faut faire vite à apporter le charbon qui s’éloigne au fur et à mesure des jours de traversée. Il faut aider les deux chauffeurs, passer le ringard,4 charger, décrasser entièrement un foyer à chaque fin de quart et apporter le charbon tout prêt pour le quart suivant. Au mouillage, pendant les escales, les grandes chaudières sont éteintes ; la petite chaudière alimente les grues, mâts de charge, cabestans, etc. Nous changeons des tubes à fumée, nous piquons le sel au fond des chaudières, nous aidons les mécaniciens à leurs révisions. Un soutier de la Compagnie Générale Transatlantique gagne quatre-vingts dix francs par mois. Sur ces cargos, nous avons dans le poste des chauffeurs et des mécaniciens, une couchette avec une paillasse, un polochon, deux couvertures, mais pas de draps. Sur ces cargos, il n’y a pas de lavabos ; il faut avoir son bidon pour se laver dans un coin de la chaufferie – ou sur le pont aux tropiques – et la nourriture est infâme. Mon chef de quart m’annonce que rentrés au port, il me fera passer chauffeur, à cent vingt francs par mois. Ce sera moins dur que soutier. Même le métier de mineur c’est de la rigolade auprès du travail de soutier de cette époque !
Au Havre, avant l’appareillage du Mont-Ventoux, pendant une semaine je n’avais pas mis pied à terre. La première escale fut à Saint-Nazaire – souvenir de mon canard – puis, Nantes, quai de la Fosse avec toutes ses rues proches et mal famées, puis Bordeaux. Ce cargo faisait de très longues escales et, à neuf nœuds à l’heure, ne filait pas vite (environ quinze à seize kilomètres à l’heure) et, à vide, il roulait comme un tonneau. C’est ce qui nous arriva à notre départ de Bordeaux. Pendant huit jours dans le golfe de Gascogne, jusqu’aux isles Açores, pris dans une tempête d’équinoxe, très peu chargé, bord sur bord, je voyais déjà le Mont-Ventoux la quille en l’air. Après ce coup de tabac, j’étais champion pour monter avec le treuil à vapeur, les bacs d’escarbilles par la manche à air et à les jeter à la mer sans en faire tomber sur la tête des chauffeurs. La plus longue traversée, de Bordeaux à la Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, durait dix-huit jours ; après, c’était de petites traversées et de longues escales où l’équipage pouvait récupérer des jours de repos, tel à Fort-de-France, en Martinique, aux Antilles et en Guyane, dans le vilain port de Cayenne où nous ne pouvions accoster par manque de fond car le port s’envase.
Le Mont-Ventoux, comme tous les navires de commerce de son genre, comprenait une trentaine d’hommes d’équipage, mais pas de TSF, pas de canons, aucune arme, pas de docteur à bord. Telles étaient encore en 1916 les conditions à bord de la plupart des navires de commerce alliés. Ils étaient coulés en quantité par des sous-marins allemands, quand ils ne sautaient pas sur des mines. Ce n’est qu’en 1917 que du plus grand au plus petit bâtiment de commerce, ils furent tous équipés de TSF, de canons de chasse et de retraite et, surtout, de grenades Guiraud contre les sous-marins. Dès 1918, les sous-marins ennemis étaient maîtrisés. Mon ancien paquebot, le Haïti, commandé par A. B., est décoré de la croix de guerre pour avoir coulé un sous-marin allemand.
Le Mont-Ventoux rentre au port le 6 juin 1916. En rade de Saint-Nazaire depuis quatorze jours, nous sommes deux malades. Le commandant H. avait voulu me débarquer aux Açores par crainte des sous-marins allemands près des côtes espagnoles où ils se ravitaillaient. Il tenta de me persuader dans mon lit de moribond, en m’exposant les périls et mon état qui m’empêcherait de me sauver. Il me sollicita pendant deux jours avant de doubler les Açores. J’avais refusé. Dans mon idée de malade, j’étais persuadé que je mourrais sur une terre, loin de ma famille qui, de ce fait, ne viendrait jamais sur ma tombe. C’était mon appréhension, « une idée de malade ». Hélas, quand on connaît les ravages de la guerre sous-marine entre les isles des Açores et les côtes d’Espagne, on peut savoir dans quelle situation les deux malades étaient.
La cabine du cuisinier et du boulanger nous servait d’hôpital, le mousse veillait sur nous. Personne à bord ne connaissait notre maladie de son nom. Le commandant H. venait souvent avec son thermomètre ; il nous avait fait cuisiner de bons plats, offert de bons cigares de la Havane, mais sans succès. Il avait baptisé notre maladie « fièvre intermittente ». Arrivé en rade de Saint-Nazaire, la police Douanes et Santé monte à bord. L’équipage est curieux, mais les officiers sont inquiets car, je l’ai appris plus tard, ils craignent la quarantaine. Le docteur déclare : « Fièvre typhoïde ; hôpitaux de Saint-Nazaire pleins des blessés de guerre ; à débarquer demain matin 6 juin 1916, à Nantes ; hôpital de l’Hôtel-Dieu ».
Je suis isolé dans une chambre avec une baignoire, seul. Sœur G. me soigne ; c’est monsieur le professeur M., avec tous les internes, qui s’occupe de moi. Trois bains par jour, dix minutes dans l’eau à trente-sept degrés, puis enveloppé aussitôt dans trois couvertures pour me faire transpirer pendant environ deux heures. Je suis un moribond porté par trois personnes, à la tête, aux pieds et au milieu. On me donne un plein verre d’huile de ricin, deux litres de tisane de queues de cerises à boire par vingt-quatre heures, du lait et une petite fiole d’extrait de café. Je souffre de la tête horriblement. Seulement toucher le bouton de la porte ou remuer une chaise doucement équivaut à un coup de maillet sur la boîte crânienne. Un infirmier, en me soignant, contracte la typhoïde.
Avec les bons soins du professeur M. et le dévouement de sœur G., je vais mieux et un jour je ne suis plus isolé. Je suis dans la grande salle ; un voisin de lit me donne un bonbon et une tranche d’orange. Dans la nuit suivante, je crie, j’appelle. L’interne vient et me demande de lui dire si j’ai mangé quelque chose. Je serai mort sans dire que j’avais mangé un bonbon et une tranche d’orange. J’ai l’impression que dans mon ventre tout se déchire. La fièvre est revenue. Tous les jours, sœurs et internes me demandent de leur dire ce que j’ai mangé, mais je reste muet. Enfin, au bout de cinquante-cinq jours de diète à l’hôpital, après cette rechute, je crie famine. Monsieur le professeur M. me donne à midi seulement pour commencer, un tout petit peu de tapioca au lait. Mon état va s’améliorant. J’apprends que mon camarade du Mont-Ventoux est mort de la typhoïde, ainsi qu’un des fils d’un boulanger, âgé de dix-sept ans. Il était sauvé et ses parents lui firent plaisir en lui donnant quelques gaufrettes. Il mourut dans la nuit par l’imprudence de ses pauvres parents.
Pendant ma maladie dans la grande salle de l’hôpital, ma mère était venue huit jours à Nantes. Étant correspondant au Chemin de fer d’Orléans, elle pouvait voyager gratuitement en seconde classe.
14-18 – Engagé volontaire dans la Marine de guerre
Guéri en septembre 1916, je rentre dans ma famille à Villeneuve-le-Roi. En octobre 1916, je signe un engagement volontaire de trois ans dans les équipages de la flotte. Je fais mes formations au 5e Dépôt de Toulon, à l’atelier flotte de l’Arsenal. Je reçois mon brevet de matelot charpentier. Nous faisons des marches en montagne, souvent accompagnés par les marins Russes du croiseur Ascooldt avec qui nous partageons notre repas et notre quart de vin pour lier l’amitié, nous disent nos officiers.
Le 13 janvier 1917 à minuit, à bord du croiseur auxiliaire Liamone, je suis dirigé à destination de l’Armée navale d’Orient ; escales en Tunisie, à Malte et en Grèce. Je débarque du Liamone et je continue à bord de l’Edouard-Corbière qui passe le canal de Corinthe. Deux mois plus tard, il est coulé, coupé en deux par une torpille.
Arrivé en rade du Pirée-Salamine, je suis embarqué à bord du croiseur Bruix et débarqué ensuite pour faire partie définitivement de l’équipage du cuirassé Patrie, mais je suis mis en subsistance, c’est-à-dire détaché, à bord de l’aviso Fauvette. A bord, trente hommes d’équipage ; nous possédons les premières grenades Guiraud contre sous-marins ; nous faisons la chasse aux sous-marins ennemis, sans jamais arrêter, sans aucun repos.
J’avais été désigné pour la Berthilde, bateau autrichien capturé et transformé en mouilleur de mines. Puis un Brestois plus ancien que moi, désigné pour la Fauvette – un navire confisqué aux Grecs royalistes et germanophiles – débrouillard ce brestois, croyant être mieux à bord de la Berthilde, avec le piston de son compatriote le premier maître-charpentier, avait réussi chez le fourrier5 à faire changer les noms sans que je le sache. Plus tard, j’appris que la Berthilde avait disparu avec son chargement de mines sans laisser de trace, et, plus tard encore, le premier maître du Patrie m’expliqua leur combinaison (le changement des noms et livrets chez le fourrier). Le Brestois, c’était son destin.

Marine Française – Cuirassé Patrie
Le premier navire de guerre qui a franchi les Dardanelles en octobre 1918 avec Franchet d’Espèrey* à son bord (à Constantinople, la Turquie). Ce jour nous avons jeté une belle couronne de fleurs sur le Bouvet par 90 m de fond (par tribord)… *Fit signer la reddition de la Turquie
Nous étions partout, dans tous les endroits mal fréquentés, par tous les temps. Plusieurs fois les Boches nous ont raté. Nous en avons surpris un en venant de doubler le cap d’une isle, arraisonnant le navire hôpital Divona stoppé et leur sous-marin à la coupée.6 Les officiers Allemands inspectant à bord du Divona, nous ne pouvons pas l’attaquer. C’était en fin d’après-midi par temps calme. Nous nous éloignâmes ; le Boche plongea et le Divona continua. Mais aussitôt arrivèrent de tous les horizons, contre-torpilleurs, torpilleurs, vedettes rapides – anglais et français – etc. La nuit était venue. Chaque navire dans son rayon désigné lâchait des grenades. Je m’occupais des nôtres avec deux canonniers sur la glissière arrière que j’avais fabriquée. Les projecteurs fouillaient la mer et tout d’un coup les canons tiraient de partout et ça sifflait. Très loin de nous, j’ai aperçu l’avant ou l’arrière, tout debout sortant de l’eau, du sous-marin allemand. Pas longtemps. Ce n’était qu’éclatements d’obus sur lui avec des gerbes d’eau énormes. Ce fut fini pour la Fauvette qui l’avait vu la première. Nous continuâmes notre route jusqu’à Salonique pour faire charbon et reprendre des munitions à la Pointe de Mikra. Le radio du bord nous confirma la destruction du sous-marin allemand, mais nous en avions des douzaines à chasser et je ne m’étends pas, ce serait trop long. Je citerai seulement quelques noms des endroits où nous chassions ; les principaux : Volo, Tarente, l’Adriatique, l’Italie, le canal d’Otrente, Patras, Céphalonie, Le Pirée, le Cap Matapan, Lemnos, Athos, Ténédos, Dodécanèse, Salonique, Milo, Malte, Zente, Santa-Maura, Bizerte, etc. Itéa, Corinthe, Salamine, Eleusis.
En 1918, je réembarque à bord du cuirassé Patrie sous le numéro 422, équipe Sécurité Milieu et Compagnie de débarquement. En octobre 1918, la Bulgarie capitule et, aux Dardanelles, les barrages de mine et les filets d’acier sont ouverts. Le Patrie est le premier cuirassé et navire de guerre de toutes les flottes alliées qui, seul, franchit les Dardanelles. Il a à son bord le général Franchet d’Espèrey, commandant en chef des alliés sur le Front d’Orient. Nous l’escortons à Constantinople faire signer l’Armistice aux Turcs vaincus avant l’Autriche et l’Allemagne. Aux Dardanelles, nous jetons une grande couronne de fleurs à la mer sur le Bouvet coulé en 1915. Puis, nous rentrons immédiatement à Salonique, au grand quartier général.
Décembre 1918 – Le Patrie repart pour Constantinople. Il s’amarre au quai de Galata, à l’entrée de la Corne d’or, le nez tout près du pont de Galata qui relie Pera à Stamboul. Le général Franchet d’Espèrey vient faire son entrée triomphale dans la capitale turque. Deux fois par semaine, je fais des promenades instructives ; je visite partout ; nos maîtres sont ou le docteur à cinq gallons, ou l’aumônier du bord, le père E. P., licencié ès lettres et ès sciences, docteur en droit, professeur au Collège Stanislas à Paris et maintenant curé à Saint-Charles de Monceau et directeur des lycées Saint-Charles de Monceau. C’était un brave homme, très bon, qui a souvent défendu des matelots devant le Conseil de guerre.

A. Doux à g.(en permission, avril 1918 arrivé d’Orient, Dardanelles, Salonique, etc.)

Prélude de la Révolte des marins Français
1919 – Matelot à bord du cuirassé Patrie, je suis ce jour-là à Constantinople, permissionnaire à terre. A la fin de cette journée, ayant mangé en ville, je remonte à bord à l’heure, réglementaire devant l’officier de quart qui me fait ordonner de rester en tenue « bleu de drap » et je suis conduit à la salle d’armes où je suis étonné de trouver une douzaine de matelots de ma section, comme moi en « bleu de drap », rentrant de terre.
Des sacos7 nous distribuent à chacun un ceinturon, une cartouchière remplie de cartouches et le gros revolver d’ordonnance à barillet tout chargé. Ainsi équipés, les douze matelots, deux seconds maîtres et un lieutenant, nous descendons la coupée, embarquons dans une vedette qui nous emmène en pleine nuit noire au milieu du Bosphore et remonte son courant rapide. Nous nous interrogeons discrètement entre matelots, mais aucun de nous ne sait où nous allons.
Nous accostons à la coupée d’un navire de commerce russe à une cheminée, tout peint en blanc ; c’est le Prince Pierre le Grand. Nous sommes placés dans un salon et un officier Russe avec notre officier parlent à l’écart. Puis, notre officier vient nous donner ses ordres. Il nous explique que l’équipage du Prince Pierre le Grand sont des indisciplinés, même bien pire. Il y a parmi eux des voyous, des bandits qui refusent obéissance à leurs officiers. Ils refusent de mettre les machines en marche pour que leur navire qui vient de France n’arrive pas en Russie. Ils ont menacé de chauffer les chaudières avec des bombes qui sont dans le chargement du navire.
Notre officier nous explique à chacun de nous à part, le rôle que nous avons à faire. J’ai la place la plus infâme, mais c’est un ordre et je ne peux refuser. Mon officier et l’officier Russe me conduisent dans une coursive en haut de l’escalier du poste des mécaniciens et des chauffeurs et me donnent la consigne de tirer, de tuer comme un chien, le premier marin Russe qui montera cet escalier et qui ferait un geste contre moi ; un surtout, le meneur, un colosse dont les officiers me donnent le signalement. Celui-là, j’avais ordre de l’abattre sans sommation. Mon officier me disait que c’était un sauvage, une brute : « N’hésitez pas, tirez, abattez-le, il est dangereux ».
Les autres matelots Français étaient placés dans la courbe des coursives, plus loin. Je suis le plus mal placé en haut de cet escalier et j’entendais l’équipage des machines, en bas, à leur poste, qui discutait dur et ferme.
Au bout d’un certain temps, un marin Russe avec un bidon et une grande gamelle me fit signe d’en bas de l’escalier qu’il avait besoin de passer pour aller chercher de l’eau ou du ravitaillement. Je lui fis signe qu’il avait le passage libre, mais il montait cet escalier doucement, craintivement. Il mit ses deux ustensiles dans une main et de l’autre, il toucha son côté pour me faire comprendre que j’étais armé. D’un geste, je lui montrai que mon revolver était dans sa garde, qu’il n’était pas sorti. Je lui faisais comprendre que je ne voulais pas m’en servir. Alors, rassuré, il s’approcha de moi. Je lui fis un sourire amical, mais ses yeux fixaient ce gros revolver. Je dis au matelot Français qui était au bout de la coursive de laisser passer.
Un instant plus tard, ce même matelot revenait avec notre officier et un officier Russe qui tous deux descendaient au poste des chauffeurs et mécaniciens. Après de longues discussions, le marin Russe, signalé « meneur », montait avec des camarades en vedette et, très tard dans la nuit, nous quittions le Prince Pierre le Grand avec le seul matelot chauffeur Russe désigné « meneur ».
Arrivé à bord du cuirassé Patrie, il fut remis dans les mains de soldats Français et emmené à terre à Constantinople. Le lendemain, nous savions que le Prince Pierre le Grand venait de Toulon avec un chargement de bombes d’avion, de munitions et d’armes, etc., destinés aux Russes Blancs contre les Russes en révolution pour leur liberté contre leurs tyrans, et que le vaillant équipage du Prince Pierre le Grand refusait de conduire ce chargement pour aller tuer leurs frères révolutionnaires rouges en Russie. Le Prince Pierre le Grand et tout son chargement n’a jamais été en Russie. Il est resté dans le Bosphore, car son équipage aurait plutôt fait sauter leur navire et eux avec.
≤≥
Les événements se sont précipités. Moi-même écœuré de ce que l’on venait de me forcer à faire, avec tous les marins Français, nous avons refusé de nous battre contre nos camarades Russes.
En mars-avril 1919, tous les navires de guerre se révoltent, gros et petits, qu’ils soient de Russie, de Roumanie, de Bulgarie, de Turquie, de Grèce, de Tunisie ou de France. C’est comme une traînée de poudre ; partout les équipages se mutinent et se révoltent. A bord du Patrie, la révolte éclate le matin au branlebas ; des mots d’ordre, des consignes sont écrits sur les miroirs se trouvant dans les batteries basses et hautes. Les marins debout avec leurs hamacs à l’épaule montent les ranger dans les bastingages. Ils ont tous l’habitude en venant d’être réveillés et passant devant ces miroirs de se regarder dedans et ils étaient obligés d’y lire les mots d’ordre. Cette mutinerie dura plusieurs semaines, malgré les belles paroles, les beaux discours, les belles promesses (ou les menaces) prononcés même par l’amiral Exelmans. Notre officier en second prenait note des plaintes, réclamations de chaque marin qui passait en ordre, selon les cas, états de service, etc. de chacun tandis que les transports alliés montaient le Bosphore vers la Russie, musique et drapeaux ; troupes Serbes, Grecques, Italiennes, Anglaises… Des transports de troupes françaises montaient aussi le Bosphore pour aller débarquer en Russie où l’on devait recommencer une guerre au printemps. La marine révoltée empêcha cette guerre contre la Russie.
En mai 1919, à bord du paquebot La Navarre, en tant que mutin au deuxième contingent des révoltés, je suis rapatrié en France et je rejoins mon dépôt, le Premier dépôt des équipages de la flotte à Cherbourg où j’embarque à bord du pétrolier Le Dordogne, le plus gros du monde à l’époque avec ses vingt-trois mille tonnes. C’était un navire espagnol ravitaillant les sous-marins allemands que nous avions capturé et gardé pour nous, mais pendant la guerre nous l’avions prêté aux Anglais. Il s’était appelé de trois noms : en espagnol, le Salvador, en anglais, le Silver Lip et en français Le Dordogne.
 A bord du Dordogne
A bord du Dordogne
A bord du Dordogne en juillet 1919, je suis en partance pour Port-Arthur au Texas, avec escale forcée aux Açores, à Florès et Corvos, pour nous ravitailler en vivres frais, notre frigo étant en panne. Rentré à Brest, je suis démobilisé le 16 octobre 1919. Je n’ai pas vingt-deux ans. Après cinq ans, la guerre est bien finie. Nous avions fait la Révolution de la Mer Noire.

Juillet 1919 – Port Arthur, Texas …alors dans la Marine marchande, ceci d’une belle Américaine : « Reviens. Ne m’oublie pas. »
Crise de 1929 – Les colonies et Dakar
Je reprends la bonne vie de famille chez mes parents qui m’accueillent bien. Je n’ai pas eu de jeunesse. Trop de mes camarades sont morts ou disparus. Je n’ai qu’un seul désir, c’est de me perfectionner dans mon métier et reprendre mes études de violon. Je rentre dans des maisons où l’on exécute les plus beaux travaux d’art. Je travaille en compagnie d’anciens élèves de l’École Boulle8 et de l’École des Beaux-Arts.
Un jour je me trouvais chez une ancienne famille de Villeneuve-le-Roi, les G. dont les enfants avaient été à l’école du pays avec moi. V., de mon âge, et son oncle J. me questionnaient et parlaient souvent avec moi. Ils m’apprirent qu’aux environs de 1910, comme ils étaient Russes, Lénine, demeurant à cette époque à Paris,9 venait souvent le dimanche chez eux, à Villeneuve-le-Roi. Ils me rappelèrent à la mémoire qu’ils m’avaient rencontré et présenté durant une promenade – en ce temps, l’avenue du Parc – et je me souvins parfaitement bien que Lénine simplement me serrât la main, sans prononcer aucune parole.
En mai 1924, j’ai 26 ans, je me marie.
En 1934, les affaires vont mal en France. Le 6 février, il éclate à Paris des troubles qui font de nombreux morts. Il y a un chômage terrible. Ma femme a un bon emploi aux Halles centrales. Sa patronne est très gentille pour elle. Nous n’avons pas d’enfants. Le travail pour moi manque et je ne veux pas être nourri et entretenu par ma femme qui travaille dur. En février 1935, je prends mon billet aux Chargeurs Réunis et je prends le Brazza à Bordeaux pour l’Afrique occidentale française (AOF). Ma femme a son emploi sûr chez ses patrons, gros mandataires.
Je débarque à Dakar et huit jours me suffisent pour comprendre que le marasme des affaires est aussi pire qu’en Métropole. Mes ressources sont très modestes et le midi au lieu d’aller manger, je vais dans ma chambre d’hôtel faire la sieste sous la moustiquaire. J’ai un bon vieux copain, père de famille, fonctionnaire, qui est à Saint-Louis. Je lui écris et il me répond de venir de suite à Saint-Louis. Je prends le train en 4e classe et j’arrive le soir à Soor, Saint-Louis, où j’ai demeuré près de quatre mois. La vie était bon marché à cette époque. Mon ami, un Noir de la Guyane, vieux camarade de la guerre 14-18, fonctionnaire aux PTT et père d’une famille nombreuse, est grandement logé. Je suis chez lui comme chez moi. Les plus belles langoustes coûtent 0,50 F (dix sous), les plus beaux poissons abondent. Tous les dimanches, avec la vieille Ford, nous partons toute la journée en brousse, à la chasse aux antilopes, aux phacochères, outardes, etc. A Saint-Louis, je fais la connaissance de braves gens. A la Mission catholique, je fréquente un jeune Parisien, le révérend père M. qui dirige le patronage Jeanne d’Arc qui se trouve dans une grande propriété. La Salle Jeanne d’Arc est au bord du petit bras du fleuve.
J’avais écrit plusieurs demandes d’emploi et je fus convoqué à la direction des Travaux Publics pour faire pendant plusieurs jours des essais dans les ateliers et subir des examens. J’ai attendu assez longtemps ma mise en route après avoir été reçu.
Mon ami Guyanais, en fin de séjour colonial de deux ans, rentrait en congé d’Europe pour six mois avec sa famille et je me retrouvais seul à Saint-Louis, sans beaucoup de ressources, mais avec la certitude que j’allais avoir une belle situation. En attendant, il me fallait un gîte et manger. Alors le révérend père M. m’embaucha pour tous les travaux de son patronage : les billards, tables, chaises, bancs, fenêtres et portes furent fabriqués, réparés. J’ai monté un portique complet de gymnastique, un grand mât pour le drapeau tricolore, des mâts dans les pignons du bâtiment et installé des antennes pour la TSF, en plus de réparer des chariots, etc. Si j’étais resté longtemps, j’allais commencer à Soor une charpente en flèche sur le clocher de la cathédrale qui est arasé en terrasse par rapport aux tornades périodiques.
Arrive le jour de la grande fête de Jeanne d’Arc. Dans la salle, il y aura un grand théâtre et je suis violoniste à l’orchestre avec mon grand ami pianiste, monsieur J. L. R., commissaire de police en AOF. Après cette fête, presque tous les soirs j’étais invité, soit chez le commissaire de police ou chez les administrateurs pour jouer du violon avec leurs dames, soit chez des ingénieurs des Travaux Publics ou autres. Le gouverneur de la Mauritanie, retraité, me fait remettre une belle enveloppe avec une forte somme d’argent en billets tout neufs de la Banque de l’AOF.
J’attends toujours d’être appelé au bureau du personnel pour signer mon contrat et dans cette attente, je travaille toujours pour le révérend père M. J’apprends aux jeunes Ouolofs la gymnastique, le trapèze et à envoyer les couleurs à huit heures et à les ramener au coucher du soleil au son du clairon, au garde-à-vous. J’ai toujours à manger et coucher. Je dors dans le bureau de la salle Jeanne d’Arc sur un lit Picot que je place tous les soirs. Les nuits à Saint-Louis sont très humides et froides. Il me manque une couverture, mais j’ai trouvé ce qu’il me faut avec le père M. : tous les soirs, je me couvre bien avec le drap mortuaire des enterrements, le drap noir avec la croix blanche et les broderies blanches. Je sais que ce drap mortuaire a servi en 1928 pour des morts du choléra, mais je suis en 1935, j’ai froid et ce drap est épais. Il n’est pas sur un cercueil et me tient chaud.

 1935 – Hôpital du Point G, Bamako, Afrique Occidentale Française (AOF), auj. Mali
1935 – Hôpital du Point G, Bamako, Afrique Occidentale Française (AOF), auj. Mali

Le Soudan Français
Fin du mois de mai 1935, j’ai tout en règle et je vais quitter Saint-Louis en regrettant les braves gens que j’y ai connus. La caution que j’avais versée à mon départ de France m’est remboursée ; je touche quatre mois de solde d’avance, ma mise en route en première classe. Deux jours de train pour deux mille kilomètres et j’arrive à Bamako, capitale du Soudan. Je reste trois jours à l’Hôtel du Niger. Je remplis les formalités aux bureaux de l’Administration et, en automobile, je continue d’aller à trois cents kilomètres plus loin pour arriver sur les chantiers des travaux d’irrigation du Niger, au grand barrage de Markala, dit de Sansanding.
Je suis chef charpentier, affecté au Point A, jonction du grand canal inducteur avec ceux du Macina et du Sahel. Travail et climat très durs ; aucuns vivres frais, que des conserves ; très mauvaise ambiance entre gradés militaires de carrière hors cadre, jaloux entre eux. Sournoisement, ils se font toutes les crasses possibles. Ces travaux s’étendent sur une superficie gigantesque et par plus de quarante-cinq degrés, le jour et la nuit. Toute marche est pénible. Un matériel formidable fonctionne jour et nuit. Les travailleurs Noirs sont recrutés comme l’on recrute normalement les soldats pour la durée normale de leur service militaire. Ils ont un livret et un matricule. Ils sont appelés « contingents », mais je les considère plus « tirailleurs pelles » que tirailleurs fusils. En réalité ils sont au travail forcé pendant deux ans, à un franc cinquante par jour. Pour la nourriture, il leur est retenu un franc par jour et les cinquante centimes qui leur restent leur sont presque toujours supprimés pour des punitions injustifiées. La plupart font remarquer que la nourriture est abjecte. Plusieurs milliers de ces esclaves, sur deux à trois cents kilomètres de travaux, dans des campements en pleine brousse, sont à la peine jour et nuit sous la surveillance non pas d’Européens professionnels qualifiés, mais de véritables gardes-chiourmes.
Nous sommes peu de Blancs par campement, pour deux à trois mille contingents Noirs. Il y a peu de civils, tout juste un mécanicien, un chef maçon ou charpentier par-ci par-là. En tant que civils, nous subissons toutes sortes d’intrigues de la part des militaires de carrière. Presque tous les militaires sont dotés d’un vélo leur évitant les marches pendant la saison sèche. Je ne peux en obtenir un et j’achète un cheval, mais je n’ai pas de selle ni d’étriers. Qu’importe, j’irai doucement en attendant d’avoir l’équipement. A la saison des tornades, mon cheval passe partout à travers brousse et les vélos ne servent plus.
Je ne peux pas citer dans cet exposé les actes inqualifiables, dégoûtants, de la part de certains militaires de carrière hors cadre en service dans ces travaux (…) Un petit exemple pour montrer la mentalité : de service au bord du canal Macina, je vois un noyé en surface descendre le courant rapide. Avec une pirogue et trois laptots,10 je rattrape le mort et le hisse à terre après l’avoir identifié par la médaille matriculée attachée au cou. Je le fais enterrer au pied d’un arbre. Le chef de chantier du Point A qui est mon chef, monsieur le Capitaine S. vient me voir à ma case le soir-même et m’eng… copieusement. Il me dit ceci : « Vous me faites faire des écritures, vous me donnez du travail de trop ! La prochaine fois que vous voyez un nègre comme ça, vous le laisserez filer plus loin, que les caïmans le mangent par là et que j’aie pas à m’occuper de tout ça ! »
Un autre jour, ce même capitaine passa la consigne aux cinq Européens que nous étions au camp du Point A, de ne plus jamais recevoir le sergent-chef B. qui était du camp plus loin, le camp du Sahel. Dans la nuit, ce sergent violait des nègres. J’ai parlé avec deux contingents qui ont subi ses violences. L’un d’eux, R., du Cercle de Dioїla, m’a tout expliqué ; la façon qu’il attaquait ces malheureux esclaves, craintifs et sans défense contre un gradé. Ce que j’ai vu, ce que j’ai entendu est moche à écrire. (…)
De temps en temps, je recevais des nouvelles de Saint-Louis du Sénégal. Tous les enfants, de jeunes Sénégalais, du patronage Jeanne d’Arc m’écrivaient, ainsi que les braves personnes que j’avais quittées là-bas. Tous les mois, j’envoyais un mandat au patronage. En brousse, au Point A, notre service postal existait écrit sur une note de service, un bout de papier. Mais en réalité, il n’existait absolument rien du tout. Au Point A, je n’ai jamais vu venir personne étant responsable du service postal. Ce service se faisait au petit bonheur la chance par des laptots illettrés, irresponsables, que le capitaine D. envoyait au petit bureau de Markala de l’autre côté du fleuve du Niger. J’ai eu plusieurs lettres perdues ainsi. Cependant, une autre note de service, datée et signée du colonel F., note n° 639/S signée à Ségou le 7 mars 1935, suite à la note 391/S du 15 février 1935, disait que chaque Européen se rendant à Markala, en service ou non en service, pourra s’entendre avec ses camarades de camp et aller faire pour lui ou pour eux les opérations postales. Donc, en service ou non, on pouvait se considérer en service. Ces notes doivent toujours être aux archives de Ségou.
Le 5 août 1935, après la sieste, je disposais de mon après-midi. J’avais à expédier un mandat et une lettre recommandée. Je demandai au maréchal des logis, le chef M., de me procurer les laptots nécessaires pour me rouler en lorry sur la voie de Tafina et me traverser en pirogue de l’autre côté du fleuve. C’était la saison des tornades et la grande crue du fleuve monte de sept mètres et s’étale sur des kilomètres de largeur avec un violent courant. Comme de coutume, ce militaire, violant les règlements, ne me donna point le personnel que j’avais droit pour me déplacer de l’autre côté du fleuve. Je partis avec mon cheval, mais trop tard et je ne trouvai pas de pirogue. Je rentrai donc à travers brousse vers le camp. Mon cheval, piqué par une bête, s’emballa furieusement. Sans selle, sans étriers, je tenais bien, mais la bride étant trop grande, le mors lui sortit de la gueule. C’était un mors indigène, spécial, qui frappe dans la gueule de l’animal. Le cheval fonça dans un poteau de fer et je fus grièvement blessé. C’est deux Bambaras qui me connaissaient bien qui m’ont porté sur leur dos jusqu’à ma case. Je me demande encore comment ces deux braves sont arrivés à me porter jusqu’à mon lit. La femme du capitaine avait voulu me faire déposer chez elle, mais j’avais refusé. Le sang coulait et je voulais être chez moi pour mourir tranquille. Le choc avait été terrible et je me sentais perdu. Il était environ dix-sept heures ; il n’y avait pas de téléphone, pas de docteur près du camp occupant deux mille travailleurs, pas un seul brancard, pas d’infirmerie. Par hasard, sur la piste ravagée par les tornades, il passa un camion qui fut réquisitionné, mon matelas servant de brancard fut placé sur le camion et je fus transporté à Sarkala, au bord du fleuve. Arriva une vedette avec à son bord un Russe Blanc du service de santé, monsieur H. Enfin, à deux heures du matin, j’étais débarqué de l’autre côté du fleuve, à Markala, dans une baraque en bois ; l’infirmerie avait des moustiquaires. Monsieur H. me fit une piqûre de morphine et c’est la seule et unique nuit que j’ai dormi durant les vingt-huit jours qui suivirent.
Le lendemain matin, pour aller à l’hôpital du Point G à Bamako, il y avait à faire en auto-ambulance près de quatre cents kilomètres, sur des pistes toutes défoncées par les tornades qui duraient depuis le 15 juin, car là-bas les saisons sont régulières et quand c’est les tornades c’est un désastre pour quelque temps. Pendant toute la journée, nous avons roulé de sept à dix-huit heures et nous sommes arrivés au Point G.
Alors, je suis immédiatement sur le billard et endormi. Le lendemain matin, les deux médecins chirurgiens de l’hôpital du Point G, le commandant U. M. et le lieutenant O., me disent « T’as eu de la veine, tu n’as rien de cassé, ça n’est que dans le gras ». Mon bras gauche gonflé était tout noir, ma cuisse droite et tout ce côté étaient noirs comme du charbon ; à la hanche droite, il y avait un trou. Tous les matins, j’étais transporté à la chirurgie et pansé. Tous les jours, la femme du chef de Cabinet du gouverneur faisait prendre de mes nouvelles et envoyer quelques fleurs par son secrétaire, monsieur A. Étant le plus souffrant, j’ai eu la visite du général en chef N., de même que la visite de Monseigneur Capra, envoyé de sa Sainteté le Pape, pour une Mission d’inspection en Afrique française, en août 1935.
Je souffrais abominablement, de jour comme de nuit, ne fermant jamais l’œil. Je déplaçais mon bras perpétuellement. L’adjudant infirmier m’y appliquait des compresses ou autres produits, mais sans résultat. Le commandant A. V. me disait : « Il y a eu rupture de vaisseaux et hémorragie interne et c’est pourquoi ton bras est noir ». Au bout de trois semaines, il me dit : « Je vois pourquoi tu as mal ; il y a un nerf de pris dans le coude ». Alors il me fit dresser à moitié assis sur mon lit, tenir par le cou à droite et à gauche par deux tirailleurs Sénégalais et se mit à tirer de toutes ses forces sur mon bras en le torsant. Je criais, je hurlais, je hurlais tellement fort qu’ils me lâchèrent tous. Le commandant A. V. me dit alors : « Tu es plus fort que moi, mais demain je t’aurais sur le billard ». Ne pouvant me mettre ni à droite, ni à gauche, sans dormir par rapport à la souffrance, je m’épuisais. Le lendemain matin, je fus endormi et je me réveillai dans une autre chambre avec le lieutenant T. près de moi qui me gardait. (Ce lieutenant avait été légèrement blessé à un genou.) Alors le commandant A. V. vint me voir et me dit : « Alors, ça y est, ton bras pivote bien, ça ne te fera plus mal ». J’essayais de faire pivoter mon bras devant lui, mais le bras ne tournait pas. Alors, le commandant me dit : « Tu as dû bouger et tu l’as redéfait ». Je lui répondis que je venais de me réveiller et le lieutenant T. affirma au commandant A. V. que je n’avais pas bougé du tout. « Bon, dit-il, mais ça va se remettre, c’est ankylosé. Quand tu reprendras sur tes chantiers, là-bas, à grimper, à cogner, toc, tout d’un coup, au moment où tu ne t’y attendras pas, ton bras se mettra à pivoter comme il faut ; pour l’instant, c’est ankylosé. Et puis, il faut te lever maintenant et aller dans la galerie et mettre la plaie de ta hanche au soleil. Le soleil, c’est bon pour ça ; ça cicatrise et ça fait guérir ». Je fis tout ce que ce médecin-chef, commandant A. V., m’ordonnait avec bien du mal, car je ne pouvais m’appuyer que sur mon côté gauche. Je questionnais les Noirs qui assistaient le commandant A. V. lors de la remise de mon coude, soi-disant, et un des Noirs me conta que je fus allongé sur le sol et que le commandant me mit un genou sur la poitrine et tira et torsa mon bras gauche ; le Noir a entendu un craquement. C’est tout ce que j’ai pu savoir.
Le commandant A. V., chirurgien-médecin chef de l’hôpital du Point G à Bamako, est légendaire là-bas pour ceux qui l’ont bien connu. C’était un alcoolique chronique, ivrogne invétéré. Il ne dormait jamais. Toutes les nuits, il se baladait dans l’hôpital, soûl, titubant et bafouillant. Il ne dessoûlait jamais. Je ne suis pas sa première et dernière victime. En 1943, j’ai appris à Madagascar par l’adjudant infirmier R. que A. V. avait été renvoyé de l’armée pour fautes très graves et rayé de l’Ordre des médecins. C’était un ivrogne.
Au bout de vingt-huit jours d’hôpital, le commandant A. V. me dit que c’est fini, que j’ai eu de la veine, que ça n’était rien du tout, rien de cassé, et me sort de l’hôpital avec ma reprise de service. Je boîte et je souffre beaucoup pour marcher. Je ne peux rien faire de mon bras gauche, mais je suis content car je crois que je n’ai rien et que tout ça va se passer. Je suis persuadé par le médecin chirurgien chef.
En ville, à Bamako, avant de prendre l’auto-postale pour rejoindre Ségou et continuer vers mon poste, je fais la connaissance de l’administrateur D. et de l’inspecteur de police P. qui m’invitent à déjeuner au buffet de la gare et ensuite rendre visite à tous leurs amis, fonctionnaires comme eux. P. est un brave type, mais il a des drôles de façons. Sa femme couche au premier étage et lui au rez-de-chaussée. Alors, quand il a besoin d’elle, il tire des coups de revolver au plafond pour la réveiller et lui dire de descendre.
Enfin, je prends mon auto-postale et me voici en route pour toute la nuit, faire les trois à quatre cents kilomètres. Je n’ose pas me plaindre tellement l’on m’a dit que je n’avais rien, mais je souffre abominablement. Arrivé dans mon camp du Point A, après avoir passé les directions de Ségou et de Markala où tout le personnel par-là est bien embusqué dans des bureaux ou à l’ombre dans des magasins, moi je reprends mon travail pénible sur les chantiers.
Trois camarades, M., V. et M., me signent une attestation que j’ai toujours en ma possession. Ils attestent que j’ai été blessé en allant personnellement porter un mandat et une lettre recommandée. Donc par la note 391/S du 15 février 1935, j’étais en service. Trois autres camarades militaires de carrière, maréchaux des Logis, D., M. et G. me donnent une attestation (…) témoignant de ma moralité, de ma conduite et de ma tempérance.
Je veux croire que je n’ai rien et j’espère pouvoir me servir de mon bras gauche qui ne pivote toujours pas. Comme la plupart des copains, je vais à la chasse aux biches, aux phacochères et aux canards. Des lions passent dans le camp dans la nuit ; des panthères et des hyènes aussi, mais ceux-là je les laisse passer. Pour oublier mon mal, j’assiste aux belles fêtes de tamtam, aux fêtes de nuit de mariage, avec les feux et les tamtams.
Mais je peux bien faire le brave, je souffre trop. Je ne peux pas me plaindre, je serais ridiculisé, traité de douillet. Au Soudan, dans cette région, de jour comme de nuit, le climat est rude et il faut être solide sur ces chantiers de bagnards où les quelques Européens s’y trouvant, s’espionnent, se surveillent et sont prêts à écraser le premier défaillant. Nous travaillons de jour comme de nuit. Mais il arrive que c’est fini pour moi : pendant trois mois depuis ma sortie d’hôpital j’ai résisté aux souffrances, mais je succombe. Je n’ai plus que les nerfs et je demande au docteur M. qui vient me voir, de me renvoyer à l’hôpital de Bamako. Ce docteur m’examine et décide immédiatement de mon transport à l’hôpital sans me donner de détails.
Arrivé au Point G à Bamako, le médecin-chef chirurgien, le commandant A. V. en fin de séjour colonial était tout prêt de rentrer en France Métropole. Il partait deux jours après mon arrivée. C’est donc son remplaçant, le commandant P. qui allait me donner des soins. Le Point G ne disposait que d’une simple installation de radiographie, très faible. Le commandant P. ne put voir l’état de ma hanche, mais il constata une fracture de l’avant-bras gauche, ce qui m’inquiéta. Je me demandais pourquoi le commandant A. V. aussi bien que le lieutenant R. ne m’avaient pas examiné à cette radio et m’avaient menti en me répétant toujours que je n’avais rien de cassé… Je restai un mois dans cet hôpital.
En tant que contractuel aux Travaux Publics, j’étais en première catégorie. J’étais à table avec les officiers et les hauts fonctionnaires. Comme partout, j’en entendais qui parlaient intelligemment et d’autres comme de véritables idiots. Monsieur H., ancien étudiant raté en médecine, fils d’un colonel, commis des services civils (par protection)11 expliquait crânement ses exploits le jour de l’émeute du 6 février 1934, à Paris. Il disait : « Nous étions dans l’immeuble qui fait angle avec le quai et le boulevard Saint-Germain ; nous occupions deux étages ; par les fenêtres, avec nos mitrailleuses, nous mitraillions tout le pont et tous les passages ; nous cernions la Chambre des Députés et la Concorde ». Alors le gros capitaine d’intendance Ch. de dire : « Ah, moi, si j’avais été chargé de mâter ces puent-la-sueur, je te leur en aurais foutu une bonne seringuée et ils auraient été calmés pour longtemps ! » Le substitut du Procureur de la République, monsieur G., lui, ne parle pas ; il souffre trop de ses douleurs dans les jambes qu’il me dit. Mais l’adjudant infirmier m’explique que ça n’est pas des douleurs dans les jambes, mais que c’est une chaude-pisse carabinée qu’il a récoltée avec une belle mousso.12
…Le lazaret13 de l’Hôpital du Cap Manuel à Dakar au Soudan Français
Le nouveau médecin-chef, le commandant P., ne s’occupe pas de moi ; j’ai l’impression qu’il complote envers moi. Il me refuse les permissions de sortir en ville, à part une seule dont j’ai profité d’aller au Bureau d’enregistrement et faire enregistrer les déclarations de mes témoins du Point A. Le sergent des entrées, (un pays, il est d’Arpajon en Seine et Oise), se nomme T. ; il m’avertit secrètement que ce nouveau médecin-chef me prépare une saleté. Ce sergent a confiance en moi et me donne l’adresse de sa femme et de ses enfants à Arpajon. Il me confie qu’il est écœuré d’avoir pris connaissance de la manœuvre qui se prépare contre moi. Il m’apprend que je vais être envoyé au lazaret du Cap Manuel à Dakar, que je serais provoqué de toutes sortes de manières pour me faire mettre en colère, mais qu’il faut que je reste toujours calme, que je ne réponde jamais mal, que je reste indifférent à toutes les provocations que je vais subir.
1935 – Le 25 décembre au soir, jour de Noël, un garde indigène s’empare de moi à l’hôpital du Point G de Bamako, avec mission de me conduire à Dakar et me remettre dans les mains des autorités à notre arrivée à cette gare où une voiture bien gardée m’attend. Je suis enfermé au lazaret du Cap Manuel. Le lazaret est pour les épidémiques – choléra, peste, fièvre jaune – il y a des cabanons pour les fous, etc. J’ai été séquestré trois mois dans ce lazaret ; clandestinement, j’ai écrit à la gendarmerie de Dakar, au Procureur de la République et à un avocat, Maître G. Un adjudant de gendarmerie est venu me voir et a recueilli ma déposition. Maître G. envoie Maître Gt me voir, lequel a réussi de décider le médecin-chef du Cap Manuel, le capitaine P., de me laisser librement sortir toutes les après-midis. Quand en ville je me trouvais avec des gens bien et qu’ils me questionnaient pour savoir où je demeurais, je leur répondais : « Je suis hospitalisé au Cap Manuel ». Ils n’en revenaient pas, ils ne comprenaient pas la plaisanterie, ils ne voulaient pas le croire et quand je leur montrais une photographie où j’étais à côté de D.C. (j’ai toujours cette belle photo), l’ancien secrétaire à D. là, ils le croyaient. G. était ancien instituteur, ancien maire de Saint-Louis, ancien secrétaire du député D., maître du réservoir d’hommes de l’AOF pendant 14-18. Il avait été interné comme fou au Cap Manuel et, tous les jours, il venait parler longuement avec moi. Il avait aussi tous les soirs une visite qui m’obligeait à me retirer ; c’était le fameux (...), gouverneur général de l’AOF (...).
Enfin, l’espèce de médecin militaire du Cap Manuel, le capitaine P., me fait radiographier à l’hôpital principal par le chirurgien commandant M. Il est ensuite porté à ma connaissance qu’il y a bien eu fracture de l’avant-bras gauche et fracture du bassin. Cet étrange médecin me parle de recasser mon bras, de me faire un cartilage au bassin… Autant de mots que je ne comprends pas et qui me font souvenir des abominables souffrances endurées à Bamako quand le bandit alcoolique A. V. me disait que je n’avais rien et que j’étais douillet.
L’année suivante, en 1936, à Paris, les radios constatent : 1) un arrachement de l’apophyse styloïde du cubitus et une fracture du tiers supérieur du radius mal consolidée, une mauvaise consolidation de la fracture du radius apportant une gêne dans les mouvements de supination, le radius venant heurter le cubitus pendant la rotation externe tout à fait insuffisante. 2) On constate à droite de la paroi abdominale des traces de cicatrices superficielles ; la radiographie décèle un effondrement de la partie externe de la crête iliaque avec arrachement d’un fragment osseux consolidé en étant abaissé et dévié en dehors.
J’ai resté trois mois au Cap Manuel qui m’ont semblé trois ans. Toutes les humiliations et toutes les provocations étaient bonnes pour moi, mais je me savais maintenant infirme par la faute d’un ivrogne alcoolique et aussi d’un service en brousse déplorable. Je comprenais la manœuvre de ces brutes pour camoufler la responsabilité de leurs confrères ignobles. Je restais muet, car je pouvais m’attendre au pire avec ces brutes (…). J’attendais stoïquement.
Janvier 1936 – À l’Hôpital principal de Dakar, je vis, gravement blessé, le cervelet à l’air, le commandant de gendarmerie M. (Il doit avoir une pension pour « blessé en service ».) Cependant, c’est de sa faute : une panthère s’était évadée du jardin de Hann ; il ne voulut pas que ses inférieurs eussent le privilège de tirer dessus pour la tuer ; il tira, la blessa, s’approcha et, tel un ressort, la panthère lui sauta dessus et d’une griffe lui ouvrit le derrière de la tête en lui mettant le cervelet à l’air. Ses inférieurs eurent du mal à tirer sur la panthère sans tuer leur commandant prisonnier blessé sous cette bête blessée. Il était en service, c’est vrai, mais il ne connaissait ces bêtes-là qu’au Jardin des plantes à Paris. Je vois encore le commandant M., exsangue et blanc comme un linge, allongé immobile sur la civière placée dans le monte-charge de l’hôpital de Dakar, aller le matin au pansement par M.
Le 1er avril 1936, mon contrat était résilié par trois médecins d’après les rapports de la brute P. ; pourtant deux de ces médecins ne m’avaient jamais vu. C’était signé « les docteurs capitaine P., commandant M. et colonel M. J’ai la photocopie de ce document qui mentionne « Inapte à servir aux colonies ; atteint du délire d’interprétation avec phases calmes et excitations plus marquées ; imprégnation éthylique ».
Le coup est bien monté, bien joué. Ils me font passer pour un dégénéré alcoolique qui ne sait pas ce qu’il raconte et surtout qu’il ne faut pas croire ce qu’il dit. Pour moi, ancien combattant, c’est la première fois que je vois des Français gradés aussi faux et lâches. Ce sont de futurs (...).

1935 - Lazaret du Cap Manuel à Dakar, Afrique occidentale française (AOF) auj. Sénégal
1936 – Fin du premier séjour colonial
Le 1er avril 1936 à 10 heures du matin, au coup de canon, le Koutoubia appareille pour Marseille via les Canaries, Casablanca, Tanger. Je suis passager de seconde classe à une table de six hommes. Nous avons éliminé un adjudant avec sa femme. Avant le départ du quai de Dakar, trois maréchaux des logis, chefs de la 6e Artillerie coloniale motorisée, sont venus me dire au revoir. Ceux-là étaient de bons camarades qui avaient démissionné des Travaux d’irrigation du Niger. Ils avaient été découragés de la façon dont les hommes – Blancs ou Noirs – étaient considérés et conduits comme des bêtes de somme, bien pire que du bétail.
Près de ma table, il y a deux femmes en grand deuil qui rentrent à Monaco, chez elles. C’est la femme du mécanicien L. d’Air France qui a disparu dans le golfe Saint-Paul avec l’avion piloté par Mermoz. Ils étaient cinq, plus un de trop, égal six. À ma table un second mécanicien d’aviso d’Air France qui participa aux recherches sur les côtes du Brésil dans ce fameux golfe Saint-Paul me raconta que, même flottant sur un morceau de bois, personne ne pourrait songer se sauver tellement cet endroit est plein de requins. La douleur de cette jeune femme accompagnée de sa mère venue de France la chercher m’est restée comme un vilain rêve. Un soir en plein océan elle me conta tous les beaux projets qu’elle avait fait avec son mari qui gagnait plus sur l’avion que sur un aviso où il était auparavant. Elle me racontait la dureté, goujaterie, de sa direction à Dakar. Elle ne voulait pas quitter Dakar, elle espérait retrouver son malheureux mari. Hélas, je savais où pouvait être son infortuné mari, mais que dire à une femme. Je l’entendais toutes les nuits sangloter dans sa cabine quand je passais dans la coursive.
J’arrive le 12 avril 1936 à Marseille, puis je retrouve ma femme, chez moi à Villeneuve-le-Roi. Je la mets au courant de tout. Je lui montre mon contrat résilié et les motifs ; je lui montre les attestations signées des témoins, dont certains plus tard par peur de leurs supérieurs se sont rétractés (…). Je prends un avocat de la Cour d’appel de Paris pour attaquer l’Administration de l’AOF. Il me demande huit mille francs que je lui donne le 7 mai 1936 en m’assurant qu’il avait gagné d’avance. Ces huit mille francs étaient les trois mois de préavis que j’avais touché pour ma résiliation. Je n’avais plus rien, que ma femme qui travaillait. Moi, j’étais infirme, je souffrais toujours et ne pouvais plus rien faire.
L’Administration coloniale de Dakar défend l’ivrogne alcoolique, le médecin-chirurgien chef de l’hôpital de Bamako, le commandant A. V., en répondant à mon avocat de prouver qu’il a commis une faute grave n’ayant pas vu mes fractures, de m’avoir renvoyé à mon travail pénible vingt-huit jours après l’accident, avec des fractures non consolidées, le bras ayant même été recassé huit jours avant ma sortie d’hôpital. Les billets, bulletins d’entrée, de sorties, etc. sont en ma possession, ainsi que toutes les preuves justificatives dont on voudrait me demander de produire.
Mon avocat me conseille de faire deux ans de séjour dans une colonie et qu’après ces deux ans, il sera certain de gagner mon procès contre le gouvernement général de l’AOF qui, malicieusement, s’est dérobé à ses devoirs. Il demande pour moi en 1936 trois cent mille francs de dommages et intérêts. L’Administration répond en défendant l’ivrogne de médecin-chirurgien chef et en déclarant en plus que je n’ai pas été « blessé en service », attendu que le vaguemestre qui portait les plis postaux, mandats ou autres, étaient les nommés P., V., etc. Ces gens-là n’ont jamais bougé de leur bureau à Markala, à l’ombre sous un ventilateur. Mais docteurs militaires comme fonctionnaires mentent pour soutenir ceux des leurs qui ont fauté contre un malheureux civil contractuel. La plupart de toute cette bande seront dans quelque temps des lâches en 1940, pas tous mais presque, lèches-bottes zélés, des traitres (…) de triste mémoire. En tous cas, Je suis bien infirme et en plus de ça sali.
Je fais ce que je peux pendant un an en France en attendant de moins souffrir et d’être plus habile, surtout avec mon bras gauche qui ne pivote plus ; je suis très maladroit pour grimper les échelles ou échafaudages. Je suis handicapé et il faut que je sois prudent.
Le Chemin de Fer franco-éthiopien
Enfin, en 1938 je me sens bien mieux et je me décide d’aller aux colonies faire un séjour de deux ans comme me l’a conseillé mon avocat. A cette époque, j’étais loin de me douter qu’au lieu de deux ans, j’allais revenir en France Métropole en 1946, huit ans après mon départ. Personne ne pouvait prévoir la destinée que des voyantes comme Madame K. (…) où ma femme, comme les gens des Halles, aimait de consulter ces médiums. Et quand je lui dis qu’en AOF j’avais remarqué et fréquenté un peu les sorciers, elle m’emmena voir cette dame K. qui pour quinze francs vous lisait tout dans le marc de café. Cette dame me raconta le passé et le présent comme je le connaissais moi-même personnellement. Quant à l’avenir, malheureusement il a été trop vrai. N’empêche qu’en sortant de chez cette médium, je fis des reproches à ma femme, lui disant que sa bonne femme n’allait pas bien de m’avoir raconté des choses futures qui ne tenaient pas debout, que toutes ses prédictions étaient invraisemblables. Elle me voyait partir, direction de l’est, la situation, tous les détails, veuf, remarié, père de quatre enfants, etc. Pas de rentrée en Europe car cette rentrée est très très éloignée. C’est ça qui m’enleva toute confiance dans cette femme, car un colonial, quel qu’il soit, ne fait pas plus de trois ans de séjour d’après n’importe quel contrat. Elle pouvait bien me dire que j’aurai une belle situation, que j’aurai à me défendre contre des jaloux terribles qui ne pouvaient rien contre moi grâce à l’amitié des Noirs qui m’aimaient bien, que je mourrai à quatre-vingt-huit ans deux heures après l’accident d’automobile que conduit un de mes enfants qui sera blessé, que dans mes vieux jours je serai riche et connaitrai même mes petits-enfants. Pour moi, tout ça c’était des sottises à dormir debout. Sauf pour ce qui était passé, je n’y croyais pas. Mais encore là, j’étais rêveur ; elle me conta des choses seulement connues de moi seul.
En juin 1938, à Paris, je signe un contrat de trois ans à la Direction générale du Chemin de fer Franco-Éthiopien, de Djibouti à Addis-Abeba, qui m’envoie aux ateliers de Diré-Daoua en Éthiopie en qualité de chef ouvrier d’entretien au wagonnage. Ma femme est avec moi. Je suis logé, meublé, une belle solde, de gros avantages, mon compte en banque s’améliore chaque mois. C’est la vie large.
Des ouvriers Italiens vont le dimanche à la chasse en camion et me font cadeau des plus belles pièces. Ma compagnie emploie comme auxiliaires de ces Italiens, tous fascistes, plus ou moins chauvins ou fanfarons. Quelques-uns sont braves types avec moi qui est leur chef à l’atelier. Leur politique contre tout ce qui est français n’est pas belle. Je suis les cours de langue italienne les soirs. Le professeur est surveillé par un fasciste. Les journaux, revues, cinéma, tout salit tout ce qui est français. Même la langue française est inférieure à la langue italienne, avec des preuves : petit, picolo ; très petit, picolino ; ils ont l’augmentatif et le diminutif qui est gracieux, tandis qu’en français l’on adjoint un adjectif. C’est ce que le professeur explique.
Les illustrés surtout salissent la France, les femmes Françaises, l’histoire de France et tout et tout. J’aurais trop à dire sur ces sujets, mais en vérité j’ai considéré les Italiens pour des pauvres types un peu prétentieux, pas très clairvoyants. Le climat, les maladies, les ont en grande partie décimés, tout jeunes et forts qu’ils étaient à leur arrivée en Éthiopie. Ils vivaient plus mal que les Indigènes du pays, aussi ont-ils perdu tout du prestige de la race blanche. J’ai vu des Siciliens et autres dans des cabanes, collés avec des femmes indigènes et des petits mulâtres. J’en ai vu un du nom de P. dont la femme blanche, italienne, était venue à Diré-Daoua le rejoindre comme bien d’autres Italiennes. G. n’a pas reçu sa propre femme et a resté collé avec son Abyssine.
Diré-Daoua n’est pas sain et malgré ma moustiquaire, à la fin de l’année 1938, en trois mois d’intervalle, j’ai trois accès de paludisme qui me secouent bien. Le docteur R. de la compagnie me fait des piqûres de quinine et je n’ai plus jamais d’accès de fièvre jusqu’en 1944 à Madagascar.
Le 17 août 1939, dans mon travail sur la toupie, une vieille machine à bois en mauvais état que j’ai signalé à mon chef de service du Matériel et Traction, je me coupe l’annulaire de la main gauche. Avec mon bras gauche infirme que je cache, j’ai perdu aussi de mon habileté. Je signale règlementairement cet accident au Palais de Justice de Djibouti pour ce que de droit. On verra plus tard, plus loin j’explique, je suis traité en accusé !

1938 - Le moulin de De Monfred* à Diré-Daoua où j’achetais du son pour mes lapins (lire « Henry de Monfreid »)


1938 – Un dimanche à Diré-Daoua (Ethiopie) ; on joue au bouchon


 Gabrielle, 1930
Gabrielle, 1930

1939 - Gabrielle, vie à Diré-Daoua, arrivée du courrier
1939 – La Seconde guerre mondiale est déclarée
En septembre 1939, déclaration de la guerre. Je suis envoyé d’Éthiopie en Côte Française des Somalis à Djibouti et je suis mobilisé, service armé, dans l’Artillerie coloniale comme premier canonnier pointeur. Les médecins militaires me trouvent « apte à servir aux colonies » même avec un doigt fraîchement arraché, tout sanglant. Je vais aux pansements tous les matins jusqu’à la guérison. Ma femme est logée et employée au bureau par ma compagnie.

Je retrouve au Fort Bouet le lieutenant M. que j’ai connu à Dakar ; maréchal des logis, chef au 6e Régiment de l’artillerie coloniale (RAC). J’étais photographié avec lui quand il était de garde au Cap Manuel. Son père était ancien capitaine de corvette ; son frère, enseigne de vaisseau, a été fusillé à Toulon, traître, pour avoir livré le chiffre14 à une nation étrangère. Lui, M., lieutenant de carrière dans l’artillerie, était un bon copain pour moi qui était réserviste. A Djibouti, il venait souvent souper chez moi et nous sortions ensemble. Il était jeune et joyeux, bon caractère.
En janvier 1940, par une circulaire ministérielle je suis démobilisé, j’ai quarante-deux ans, et renvoyé en territoire italien en affectation spéciale aux ateliers de Diré-Daoua.
En mai-juin 1940, c’est la défaite en France. Le 3 juin à Djibouti, ma femme est évacuée de force comme presque toutes les femmes et enfants par l’Autorité française (autorités supérieures, général Le Gentilhomme et gouverneur) vers Madagascar.
Et moi, en Ethiopie, par la faute de ma direction et du Consul français monsieur P. (...) je suis prisonnier des Italiens. Je subis mon premier bombardement pendant vingt minutes par des Blenheim15 anglais qui viennent détruire le dépôt des locomotives, le camp d’aviation et un dépôt d’artillerie italienne. J’ai pris tout le plafond sur la tête et un collègue, monsieur M., pas loin de moi, a été décapité. Le lendemain matin nous étions conduits à la frontière de la Somalie pour être échangés contre des Italiens et leur Consul restés à Djibouti. J’ai abandonné tout mon outillage et la plupart de mes affaires personnelles dont j’attends toujours d’être indemnisé.
Aussitôt arrivé à Djibouti le 17 juin 1940, je suis remobilisé dans l’Artillerie, service armé, jusqu’en octobre 1940, puis redémobilisé et mis à la disposition de ma direction du Chemin de fer franco-éthiopien qui ne roule à présent que pour les Italiens, nos vainqueurs.

Diré-Daoua, Ethiopie, mai-juin 1940
Transport de matériel de guerre italien
.jpg)
Le Blocus de Djibouti
Ici commence une période tragique pour moi dont j’ai le récit sur d’autres dossiers (...) Très peu de militaires et civils ont été « bons Français » à Djibouti. La majorité a collaboré pour la victoire des puissances de l’Axe. Autant pendant les deux années qui viennent de s’écouler, que j’ai été heureux, tranquille avec ma femme heureuse d’être près de moi. C’était le bonheur et la joie de vivre et de me voir rentrer trois mois, bientôt en congé France, avec de belles économies, puis repartir et ainsi de suite. Mais les pires malheurs vont me frapper.
Notre gouverneur (...) ne veut pas se rendre. Il espère que Rommel va battre la 8e armée à Montgomery et que les escadres japonaises vont arriver avec l’armée japonaise à débarquer à Madagascar et dans tout l’Est africain en battant les Afrikanders. C’est pourquoi le blocus britannique est implacable. La Mer Rouge est la clé du passage de tous les transports. C’est trop sérieux pour Montgomery.
Je suis des réfractaires au gouverneur vichyste que Pétain a envoyé nous terroriser. Il y a beaucoup de mouchards. Je suis inquiété et menacé par (…). Les condamnations à mort pleuvent. Je passe au travers par miracle. Un ancien combattant de Verdun, une femme enceinte, un gamin de quatorze ans et une trentaine d’autres sont fusillés par ordre du gouverneur. Un de mes amis est fusillé pour le même acte que j’ai fait déjà bien avant lui, mais je n’ai pas été dénoncé.
Djibouti est un enfer. Il n’y a plus rien à manger ni à boire que de l’eau salée. J’ai maigri de vingt-cinq kilos. Tous les jours il meurt de faim une quinzaine de tirailleurs Sénégalais et Malgaches qui ont cependant une toute petite ration de plus que les Européens.16 Certains deviennent fous furieux et assassinent à coups de coupe-coupe ou de fusil les Européens gradés ou non qui se trouvent à leur portée. Ces malheureux sont abattus comme des bêtes enragées. Le médecin chef, le colonel L., chef du service de santé, de désespoir se suicide en se pendant.
L’amiral Platon17 arrive en avion et tous les soirs par radio raconte que nous sommes des héros, des martyrs, etc., que les Anglais sont des bandits, etc. etc., puis il repart voir son ami Pétain à Vichy où il fait moins chaud et où il y a de la verdure.
Pendant des mois je meurs de faim, sans nouvelles, mouchardé, traqué par les collabos. Je perds l’espoir de survivre à la famine. Un jour, je suis convoqué au Palais de Justice pour mon accident de travail du 17 août 1939, où j’ai eu l’annulaire gauche arraché. La Loi sur les accidents de travail n’était pas promulguée à Djibouti. Procureur, juge et greffier étaient tous ignorants de cette loi. Ils m’avaient fait payer des provisions, une avance, pour juger cet accident. J’ai encore le dossier et toute la paperasserie de ces ignorants. Enfin, ils me redonnent la somme avancée par moi en s’excusant et me disant : « On s’est trompé ; pour un accident de travail, vous ne deviez rien payer ». Le procureur R., copain à mon directeur, jouait tous les soirs ensemble au tennis. Je devais avoir cinq pour cent d’invalidité, mais au tribunal je fus rudoyé, intimidé, traité en coupable et non en victime et le procureur et juge me donnèrent trois pour cent d’invalidité, ce qui faisait trois-cent-soixante-neuf francs par an ; un franc par jour pour un doigt enlevé par une machine en travaillant. (Et à présent le gouvernement de réactionnaires a supprimé ma pension, ainsi que toutes celles en-dessous de huit pour cent !)
C’est durant le Blocus de Djibouti que j’appris la mort de ma femme, réfugiée à Madagascar. Le dimanche 1er décembre 1940, à midi, un camarade cheminot comme moi vint me trouver place Ménélik, à l’Hôtel Continental, et me dit : « Notre directeur t’a cherché ce matin, il faut que tu viennes de suite avec moi voir le commandant de Cercle ». Mon camarade V. était tout bouleversé et ne répondait pas à mes questions. J’étais angoissé, inquiet, et ne voulait pas le faire paraître car, quelque temps auparavant j’avais fourni à sept gradés, des camarades de la Coloniale, militaires de carrière, les moyens de quitter la Somalie en boutre18 pour gagner Aden et rallier les Forces Françaises Libres (FFL). J’avais aussi envoyé un plan et message à Aden à Mister Grey, ancien consul britannique expulsé de Djibouti par notre gouverneur (…). J’avais bien d’autres choses encore à craindre. Je craignais d’avoir été dénoncé en voyant la figure triste de mon camarade. A mes questions, il demeurait muet avec des yeux suppliants plein de larmes. Je devenais inquiet sur mon sort.
Arrivé devant le commandant de Cercle, monsieur L. (...), celui-ci me tendit un télégramme sans fil du gouverneur général de Madagascar à gouverneur de Djibouti, ainsi conçu : « Madame Doux décédée le 29 novembre 1940 - embolie suite pneumonie ». J’étais assommé. Je refusais de le croire. Mes yeux étaient fixés sur ce papier que je voulais menteur. C’était pas possible, invraisemblable.
En sortant du Cercle, écroulé et pleurant, un camarade me prit par les deux épaules en me secouant et me dit : « Ne pleure pas devant les Indigènes, prend le taureau par les cornes et soit brave comme tu en as l’habitude ». Ce bon camarade était Roger Donnart. (...)
Celui-ci a été dénoncé plus tard, puis arrêté par M., chef de la Sûreté (…) aujourd’hui blanchit et en service à Paris. Donnart, gaulliste, fut fusillé par ordre du gouverneur N., le 16 décembre 1941, un an après la mort de ma femme. Par le commandant René Sanner, greffier au Tribunal Militaire de Djibouti,19 je suis au courant de tout sans exception y compris de l’exécution (…). Trois mois après sa condamnation à mort – enquêtes zélées et instruction idiote – Roger Donnart est emmené le matin de la prison de Djibouti pour Galmaёl, au poteau. En sortant de la prison, il aperçoit des camions militaires avec toute la smala. Avant, il avait été dans la cour de la prison et serré la main aux copains en disant adieu. Les copains lui demandaient : « Où vas-tu ? » « Au poteau ! », il répondait. « Mais non ! », disaient-ils. « Ah bien, si vous ne le croyez pas, aurevoir quand même ! » Il a vu son cercueil dans l’un des camions. Il ne voulait pas du bandeau sur les yeux en disant au colonel T. : « Vous me faites rigoler avec votre Règlement (car le colonel lui avait répondu « C’est le Règlement. ») Il a insulté le commandant de Cercle, monsieur L., en disant : « Il est là, celui-là ! Ah, quand il sera mort, que son âme aille reposer sur un tas de m… ! ». Et se trouvant près du lieutenant aumônier, il avait ajouté : « Ah, pardon, monsieur l’Aumônier, j’ai fait un péché ».
Le médecin lieutenant M. tâte le pouls de Donnard et dit : « Il est mort ». L’adjudant du peloton s’avance, tire le coup de grâce derrière l’oreille. Il tire plusieurs fois la gâchette de son revolver, mais aucun coup ne part, c’est enrayé. Alors le colonel T. sort son revolver en disant : « Tenez, le mien marche bien », mais juste à cet instant celui de l’adjudant partit. Roger Donnard est écroulé, mais toujours attaché au poteau, un grand trou dans le dos. Pendant une demie heure il est resté attaché au poteau, le couvercle du cercueil avait été cloué et ils n’arrivaient pas à déclouer ce couvercle pour mettre Donnard dans sa boîte et le porter au cimetière à Ambouli.
En pleine sieste, ce jour-là, j’allais voler des lauriers dans le jardin de mon sous-directeur, monsieur M., et le soir de son exécution, la tombe de Roger Donnard à Ambouli avait de beaux bouquets de fleurs toutes fraîches, des lauriers rouges et blancs.
Enfin, fin de 1941, je reçois en plein blocus un dossier de Madagascar passé par bateau, sans doute par l’antarctique pour éviter Le Cap, par l’Atlantique, puis en avion Croix-Rouge Italien qui ravitaillait le gouverneur, via Bengazi, Gondar, enfin Djibouti. Ce dossier qui a mis très longtemps pour arriver à Djibouti, mais dossier officiel des autorités de Madagascar, contient des rapports, des photos, etc. adressés à moi en réponse à des questions que le chef de Cabinet, monsieur J. de Djibouti, avait demandé par sans fil au gouverneur de Madagascar. Du courrier avait été carbonisé, l’avion Croix Rouge italien à son atterrissage à Djibouti avait été mitraillé et incendié par un avion anglais. Sa contrebande était terminée, il n’apportait qu’à manger et du courrier pour la Commission d’armistice italienne. (…) Tout n’est que mensonges scandaleux. Ils ne pensaient pas qu’un jour j’irai à Madagascar. Je ne cite que quelques passages grotesques et faux de ces rapports (…), ainsi : « Madame Doux était toujours gaie ; elle n’a jamais été malheureuse, ses amies venaient la voir ; elle refusait de se soigner ; elle est morte rapidement sans souffrance ; son cercueil en palissandre est zingué et plombé en prévision de son transfert plus tard ; elle repose dans le caveau municipal du cimetière de Tananarive (deux photographies de ce caveau sont jointes aux rapports, une de face et une de côté) ; son mari était représenté aux obsèques par le gouverneur de la Première Région, monsieur H.
Puis les Domaines, Successions et Biens vacants, m’envoient en même temps, l’inventaire de ce qu’ils en ont vendu, des sommes récupérées, etc., et de la soustraction, appelée « droits de succession » qu’ils ont gardés pour eux dans leur caisse, soit vingt-cinq pour cent. Un quart ! Ces messieurs ne souffrent de rien à Madagascar, dans leurs bureaux, et moi je suis en train de crever à Djibouti. (...) Ma femme est morte et ils se partagent le butin, même mes lames de rasoir que j’avais par centaines dans une valise, en réserve, sont vendues pour périssables.
Le gouverneur de Djibouti décide de forcer le Blocus
Le gouverneur veut forcer le blocus. Trois sous-marins vichystes arrivent de Madagascar avec l’aviso d’Iberville. Le pétrolier Elorn est rempli de dix mille tonnes de gazoil et il fonce vers Madagascar escorté de l’aviso Chef de file et des trois sous-marins vichystes. Ce sont Le Glorieux, Le Monge et Le Vengeur. L’Elorn a embarqué cent-cinq passagers sacrifiés, des malades, des condamnés à vingt ans de bagne pour tentative de rejoindre les Forces Françaises Libres, pour résistance, suspects, etc. Moi, j’ai été désigné suspect, catalogué communiste que j’ai appris plus tard. Enfin ce 16 janvier 1942, je faisais partie des cent-cinq passagers affamés.
Des malades meurent et on les jette à la mer sur une glissière improvisée, avec une gueuse20 attachée aux pieds. Il y a alerte. Nous stoppons avec les trois sous-marins en coupe, vers le cap Gardafui. Le d’Iberville part et revient nous rejoindre deux jours plus tard et nous nous remettons en route en zigzaguant la nuit vers le nord, l’ouest, l’est, le sud. En matelot, je voyais les manœuvres à la roue des vents. J’ai appris plus tard qu’un sous-marin britannique avait eu mission de couler L’Elorn avec ses dix mille tonnes de gazoil destinés aux Japonais pour leur proche débarquement à Madagascar qui était prévu pour mai-juin 1942. Nous n’avons pas été coulés pour la raison suivante : par radio entre le d’Iberville, Aden, Djibouti, Vichy et Londres, il a été décidé que si L’Elorn est coulé, les trois sous-marins torpilleront tous les transports britanniques de troupes, matériel, etc. En janvier 1942, Montgomery bat en retraite devant Rommel qui est presque au canal de Suez. Montgomery a absolument besoin des renforts qui sont en route, mais si les trois sous-marins vichystes torpillent tous ces renforts, c’est un désastre pour la 8e armée britannique. Et l’amirauté de Londres donne l’ordre de laisser passer L’Elorn, son gazoil et moi avec.
≤≥
Arrivés à Diego-Suarez, les militaires sont restés là, ainsi que les quatre navires de guerre (L’Elorn était pétrolier de guerre armé). Les civils, nous sommes débarqués et rembarqués sur un petit bateau des Messageries Maritimes, le petit caboteur Général Gallieni qui va nous mener à Majunga via Nossy Bé.
Tout est changé. Il y a à manger, le climat est moins dur, les hommes commencent à avoir des sourires. Deux jours d’escale à Nossy Bé et de grandes fêtes en notre honneur, une réception aux gâteaux, champagne, de belles dames en robes de soirée, des fonctionnaires en blanc chamarrés d’or ; des discours pour nous, des éloges aux héros que nous sommes, tout ça dans un pays merveilleux ! Des camarades sont emmenés en auto visiter les plantations, les propriétés. Moi, deux dames, la mère et la fille, viennent me chercher. Elles demandent monsieur Doux. C’est la femme et la fille du commissaire de police qui fait fonction de juge-procureur, directeur de la prison, etc. Elles m’emmènent chez elles déjeuner avec le commissaire de police de Nossy Bé, monsieur P., qui m’apprend qu’à Tananarive, en 1940, sa femme et sa fille étaient amies avec ma malheureuse et défunte femme, qu’elles se connaissaient très bien, ainsi que lui aussi qui me fit l’éloge du courage de ma pauvre femme disparue après presque dix-sept ans de mariage heureux.
Le petit Gallieni partit pour Majunga où j’ai resté huit jours pour avoir une place dans le car qui devait me conduire sur les hauts plateaux de Tananarive. Huit jours à Majunga au Grand Hôtel et il y avait des grandes fêtes et discours pour nous (les héros).
Comme à Nossy Bé, nous étions invités, reçus officiellement, mais j’étais gêné : je ne pouvais ni boire ni manger et l’on me forçait d’avaler, mais c’était impossible. Plus tard, j’ai compris que ce manque d’appétit m’avait probablement sauvé la vie, car des camarades tomberont gravement malades et certains mourront par éclatement de la rate. Des années plus tard, beaucoup de mes camarades mourront des suites du Blocus de Djibouti, quand d’autres resteront malades toute leur vie. Quant à moi, je serai faible et convalescent pendant mes cinq premiers mois à Madagascar.
Enfin, j’arrive à Tananarive la nuit du 8 février 1942. À mon réveil le matin, un beau soleil, température douce, des fleurs de toutes sortes partout, des tables bien garnies, des gens qui sourient, qui chantent. Ce changement brusque est trop brutal pour moi. Je crois rêver. Je vais à côté au zoma,21 j’achète un gros bouquet de fleurs. J’appelle un pousse-pousse pour la première fois et je dis au ringa : « Au cimetière ! » Quel soulagement, quelle tristesse s’empare de moi. Je lui apporte ce joli bouquet et tous les jours je reviendrais là, sur sa tombe. Certains camarades eux, ont la joie d’avoir retrouvé leur femme et leurs gosses.
Réfugiée à Madagascar
Ma femme réfugiée à Madagascar, sans nouvelles de sa famille de France ni de moi bloqué en Somalie, meurt de chagrin à Tananarive le 29 novembre 1940, jour de ma fête (...).
En novembre 1940, j’avais emprunté de l’argent à ma compagnie à Djibouti que j’avais expédié par sans fil à ma femme évacuée de force à Madagascar. Quand elle mourut, l’Administration de Madagascar s’empara de vingt-cinq pour cent pour droits de succession, puis vendit toutes les affaires de ma femme et s’empara encore de vingt-cinq pour cent de la somme pour droits de succession ! Puis on m’envoya la lettre explicative que j’ai reçu longtemps après à Djibouti où j’étais bloqué à crever de faim par quarante-cinq degrés à l’ombre avec de l’eau salée à boire.
En octobre 1940, un seul bateau, L’Espérance, parti de Madagascar, fut arraisonné et confisqué par les Anglais et remis aux FFL. Seulement des femmes de fonctionnaires, avec leurs enfants et même des chiens, avaient eu le privilège de quitter Madagascar pour revenir près de leurs maris fonctionnaires à Djibouti. Elles avaient été débarquées de L’Espérance à Aden et envoyées à Djibouti vichyste à bord d’un petit caboteur indien autorisé ce jour-là à rentrer à Djibouti. Par la suite, plus rien ne rentrait ni ne sortait. Les autres malheureuses femmes de non-fonctionnaires sont restées à Madagascar séparées de leurs maris bloqués à Djibouti pendant quatre ans. Certaines sont mortes, d’autres ont abandonné leurs maris. Des foyers détruits.
Des lettres de ma défunte femme qui me sont arrivées tardivement, en ma possession et que je conserve, écrites quelques semaines et quelques jours avant sa mort, me confirment la goujaterie de certains (...). Elle se plaint qu’en octobre 1940, les femmes de fonctionnaires à Djibouti, évacuées sur Madagascar en juin 1940, sont privilégiées d’être rapatriées avec leurs chiens. Elles reviennent à Djibouti auprès de leurs maris. À ce moment, ma femme quitte Tananarive et demeure à Tamatave avec l’espoir qu’un bateau la ramènera près de moi à Djibouti tout comme ces dames avec leurs chiens. Elle demeure à Tamatave dans un hôtel qui spécule et profite des réfugiées de Djibouti ; hôtel sans moustiquaire, sans confort, elle dépense les petites économies qu’elle a emportées du ménage. Mais le blocus britannique est commencé contre tous les territoires vichystes (...) et plus aucun navire vichyste ne passera plus.
Coupée de tout, plus de nouvelles. Avec désespoir, elle reprend le train et remonte à Tananarive où monsieur R., haut fonctionnaire, place de la Gare rassemble toutes les réfugiées de Djibouti. Deux tréteaux avec des planches dessus, il y monte et il déclare aux femmes réfugiées qu’il sait qu’elles ont de l’argent avec elles et qu’elles doivent se subvenir en dépensant jusqu’à leur dernier sou et qu’après l’Administration de Madagascar verra ce qu’il aura à faire pour elles s’il y a lieu. Ces gens de Madagascar, embusqués, n’ont souffert de rien ! Certaines femmes d’officiers n’avaient nullement besoin, mais des femmes d’employés de sociétés ou de compagnies privées comme la mienne, furent frappées de stupeur et démoralisées. Certains (...) de Madagascar profitèrent de leur détresse. Ces malheureuses étaient dans l’impossibilité de nous écrire à Djibouti où nous étions ignorants de ces goujateries, bloqués.
Ma femme trouve une place à trois cents francs par mois, vendeuse chez un épicier Grec M., mais avec les fatigues des voyages sur le pont du bateau Szelandia, le chemin de fer, les tracasseries de pensions à hôtels et ainsi de suite, avec ses problèmes de bagages, pas de nouvelles de sa famille de France ni de moi, elle tombe malade. Ma femme n’avait jamais de sa vie connu aucune maladie. Elle avait été pendant quinze ans, première vendeuse au Pavillon 12 aux Halles Centrales à Paris. Elle demeure avec madame M. où elle partage le loyer et logement de deux pièces et cuisine, place Soarano à Tananarive. Elle a écrit que le docteur E. est un (...), qu’elle souffre beaucoup et que ce docteur ne se dérange pas pour venir la soigner. Il lui donne de la quinacrine.22 Transportée à l’Hôpital Colonial de Tananarive - médecin-chef, le colonel T. - elle meurt huit jours après, le vendredi 29 novembre 1940, à 13 h 15, en criant et en appelant le médecin – « Vite ! Le médecin ! » – mais personne n’était là, tout le monde à la sieste. Les infirmières absentes (Mlle L. C.) sont arrivées quand elle était morte. Témoin, la femme du colonel d’intendance, H. R., occupant la même chambre que ma femme. Reposant dans la salle mortuaire de l’hôpital, le lendemain de la mise en bière, ses amies ne la reconnurent pas, car elle avait la bouche de travers et le sang coulait de sa bouche.
En 1943 à Madagascar, j’ai fait discrètement toutes les enquêtes moi-même qui m’ont éclairées plus tard. Ainsi, j’ai constaté que la salle mortuaire, avec la salle d’autopsie à côté se trouvaient toutes seules dans un petit bâtiment un peu isolé. Quand il y a un corps de déposé dedans, il y a une lumière allumée, la porte n’est jamais fermée à clé, il n’y a personne pour garder, ni veiller. Entre qui veut, le corps est seul, enveloppé dans une toile blanche, sorte de drap. Dans la fin de l’année 1943, un matin j’ai rentré seul dans cette salle ; un corps enveloppé était allongé sur la civière, exposé au milieu de la salle avec l’ampoule électrique allumée au-dessus. La veille au soir, une jeune créole était morte à l’hôpital. J’ai ouvert le drap pour voir sa tête qui était remplie de petites taches de rousseur. Un jour, un fonctionnaire du chemin de fer de Madagascar, un nommé T., d’un cancer mourut dans cet hôpital. Sa femme – qui fit parler beaucoup d’elle autant pour sa conduite légère et autre – demanda au docteur de l’hôpital d’enlever les bridges en or de la bouche de son mari décédé. Le docteur refusa, mais Madame T., avec un boy Malgache, entra dans la salle mortuaire où reposait le corps de son mari et, avec une pince plate d’électricien, arracha de la bouche de son mari mort les deux bridges en or qu’elle conserva avec elle.
Ma femme fut inhumée le samedi 30 novembre 1940 au cimetière de Tananarive.
Le cimetière de Tananarive
Arrivé à Tananarive en février 1942, j’ai été tous les jours au cimetière porter des fleurs ou me recueillir sur le caveau municipal où reposait ma malheureuse, car avec mes documents et photos officiels, j’avais trouvé facilement le caveau municipal. Souvent, des camarades évacués de Djibouti comme moi m’accompagnaient avec des gerbes ou des plantes. C’était pour moi un grand confort d’être auprès d’elle qui avait été si bonne pour moi pendant dix-sept ans de mariage heureux. Sur sa tombe, pendant un mois, le caveau municipal était mon lieu de pèlerinage et de recueillement de tous les jours.
Un matin, je fus invité à rendre visite à un notable, commerçant de Tananarive, Juif et franc-maçon nommé C., tailleur d’habit, marchand de confection, fabricant de cercueils, entrepreneur de funérailles, propriétaire d’une écurie de chevaux de courses pour le champ de courses de Mahamassina. Je trouvai ce monsieur C. dans son magasin, près de la place Colbert, car il habitait hors du centre de la ville où j’ai été visiter ses propriétés et écuries de course.
Ses questions m’étonnèrent, ses déclarations me stupéfièrent. Il m’interrogea me demandant si depuis mon arrivée à Madagascar j’avais été au cimetière sur la tombe de ma femme. Je répondis « Oui, Monsieur, tous les jours. » Alors il me demanda si je savais où était inhumée ma femme. « Certainement, lui répondis-je, je suis informé officiellement par les Autorités supérieures de la colonie qui m’ont fait parvenir à Djibouti ces documents m’indiquant l’endroit exact où repose ma femme et tous renseignements. » Et je présentai à monsieur C. les documents officiels bien expliqués, détaillés, tampons, cachets, datés et signés. (…) Ces (…) hauts fonctionnaires ont signé renseignements et rapports faux et (…) ils ont joint à leurs déclarations (…) deux grandes photographies, une de face et une de côté du caveau municipal de Tananarive où soi-disant reposait madame Doux, ce qui était faux. (…)
En mars 1942, sur le coup, je ne comprends rien. Je ne connais pas Madagascar ni la mentalité de toutes ces races métissées entre elles et qui se jalousent toutes plus ou moins : Européens (Grecs), Mauriciens blancs et de toutes les couleurs, Réunionnais blancs et de toutes les couleurs, Arabes du Golfe persique, Noirs Cafres, Chinois, Hindous, Malgaches (Hovas, Betsileos, Betsimisares, Sakalaves), etc. Après mon étonnement d’avoir été me recueillir sur le caveau municipal, où ma femme n’y reposait pas du tout, elle en était loin, monsieur C. porte à ma connaissance qu’elle n’est pas dans ce caveau municipal, qu’elle est dans son caveau à lui et que la location annuelle y est bien plus chère que celle du caveau municipal. Je lui exprime ma crainte d’avoir des frais trop élevés. Il me tranquillise en m’assurant qu’il ne me fera rien payer jusqu’à la fin des hostilités, époque où les restes mortels quitteront son caveau pour être rapatriés en France métropole dans la famille qui réclamera le rapatriement. Ça coûte cher et ça rapporte à l’entrepreneur.
Monsieur C. est aimable avec moi ; il m’invite quelques fois et va même me conseiller de me remarier avec l’ex-maîtresse – mère d’un enfant – d’un gros industriel de l’air liquide, assassiné d’un coup de revolver par sa femme. Il me fait visiter une entreprise avec toutes les machines et matériels, me disant que j’aurais toute l’aide utile si j’épousais cette femme avec son enfant que j’ai vus une fois sur le champ de course. Ça n’était pas ma destinée.
Je me remarie avec une Réunionnaise de bonne famille, son père est receveur principal des Postes et son frère aîné, directeur des Postes aux Colonies. Elle est légèrement teintée comme on dit là-bas.
Alors monsieur C. me convoque et me demande d’enlever ma défunte femme de son caveau, qu’il a besoin de la place. Il m’explique qu’il a déjà refusé deux places pour des enfants décédés qui n’auraient, à eux deux, occupé que la place de ma défunte femme, en conséquence, qu’il perd deux loyers pour un qu’il ne touche même pas. J’étais étonné de ce changement d’attitude de monsieur C. J’étais remarié, mais mes sentiments et ma peine étaient renfermés dans moi. Je souffrais sans rien faire paraître à personne. Je répondis à monsieur C. d’avoir lui-même à la transporter dans le caveau municipal où des documents officiels en leur temps m’avaient informé qu’elle y reposait. Il me répondit que ce caveau municipal était plein. Je lui dis : « Je vais demander conseil au Comité d’entraide de guerre ». Alors monsieur C. me répondit : « N’allez pas voir ces putains-là, elles me feraient taxer mon caveau et je n’aurais plus qu’à reboucher le trou avec de la terre. Attendez quinze jours, j’ai une dizaine de corps à déplacer dans le cimetière, on va voir ».
Pendant ces quinze jours, je me renseigne à l’Hôtel de Ville, Service voierie, où un employé Malgache m’apprend bien des choses (…), de tout ce que monsieur C. m’a expliqué. Ce que cet employé Malgache m’apprend, je découvre (…). J’apprends que monsieur M., directeur des Pétroles, décédé avant ma femme, est déposé dans le caveau municipal, que monsieur C. a des instructions de la Compagnie des Pétroles, France, ainsi que des fonds pour le cercueil zingué, plombé, etc., conservation dans son caveau, des frais de rapatriement du corps en France. C’est un bon client à monsieur C., il est presque payé d’avance et ça rapporte sans que monsieur C. y mette la main.
Ainsi en 1942, le corps de monsieur M. est réellement dans le caveau municipal. L’employé Malgache de la voirie constate et m’affirme que monsieur C. ne paie même pas le modeste loyer du caveau municipal occupé (…) par le cercueil de monsieur M. Officiellement, monsieur M. n’est pas dans le caveau municipal, il est officiellement dans le caveau de l’entrepreneur monsieur C. et que monsieur C. touche et touchera tous les gros loyers que la Compagnie des Pétroles a payé et paiera pour dépôt du corps de monsieur M. dans le caveau à monsieur C. et monsieur M. n’est pas là, mais monsieur C. touchera comme si monsieur M. était là.
Monsieur C., franc-maçon, avec (…) économise ainsi des places dans son caveau. De plus, avec les (…), il est assuré d’être mis en relation avec les familles, directions, compagnies, sociétés, etc., résidants en Métropole pour traiter des exhumations et transports etc. qui lui rapportent gros. Un commissaire de police est présent pour les scellés et toute opération de transfert de corps, verbalisé, etc. (…)
Monsieur C. m’informa du jour et heure d’une demie douzaine d’exhumations et réinhumations. J’étais accompagné de mon ami le commandant S. arrivé aussi à Tananarive et Monsieur le commissaire de police G., commissaire d’Antananarivo était présent. Je n’avais parlé absolument à personne de mes constatations sur (…), seulement au commandant S., ex-greffier du Tribunal militaire de Djibouti. A droite, au fond du caveau municipal, un corps fut retiré et mis en terre en fosse commune sous prétexte que sa famille en France ne donnait pas de nouvelles. En 1942, toutes communications étaient coupées. Comment les familles en France auraient-elles arrivé à connaître ce qu’il se passait à Madagascar ou ailleurs (comme moi de Djibouti) ? Les (…) ne s’occupent pas de ça, pas de sentiments, c’est l’argent qui compte pour eux.
Le corps d’un Martiniquais, administrateur chef, fut retiré d’un caveau privé et placé à la place de celui-ci, au fond et à droite dans ce caveau municipal. Dans ce caveau municipal, en haut sur une dalle à droite, on retira le corps de monsieur M. qui fut transporté au caveau de monsieur C. De ce caveau fut retiré le corps de ma femme, transporté dans le caveau municipal en haut et à droite. Ce caveau avait plein d’eau sur les dalles en étagères. Ce caveau était défectueux, humide, rempli d’eau. Alors je descendis dans ce caveau et je mis trois rangées de briques sous le cercueil de ma femme pour l’isoler de l’eau et empêcher le bois de pourrir.
≤≥
France – De 1945 à 1951, le Service de la voierie de Madagascar me réclame tous les ans le loyer de leur caveau mal bâti, avec avertissement du délai pour mettre à la fosse commune si je paie en retard. Je leur envoie tous les ans le prix du loyer en signalant que le caveau est mal construit, que les cercueils vont pourrir et occasionner des dépenses pour le rapatriement du solide cercueil de ma femme, que j’ai vu. Ce service me répond que leur caveau est en parfait état, très sain, que tout se conserve dedans indéfiniment.
En 1949-1950, pendant mes démarches pour le rapatriement de sa dépouille en France, je reçois une lettre de l’Administration de Tananarive m’informant que les services compétents de Madagascar ne trouvent aucune trace de madame Doux. L’Hôpital colonial de Tananarive n’a jamais connu de madame Doux, née S., Jeanne, Albertine. Les services de l’Hôtel de Ville ne la connaissent plus, elle n’existe plus au cimetière de Tananarive. Alors je me demande si je rêve. Je vérifie dans mes dossiers, toutes les lettres, talons des mandats des loyers annuels de ce caveau, etc. Je me demande s’ils n’ont pas retiré le cercueil et jeté en bas de la colline, au fond du cimetière, cette malheureuse sans famille là-bas.
J’écris une lettre au siège des FFL, au vieux camarade le colonel M. qui m’informe qu’il signale mon cas qu’il considère incroyable. Enfin, ils ont retrouvé ma défunte femme. Je suis informé des conditions et dates pour son rapatriement en France. Je suis informé que son cercueil zingué et plombé est en très mauvais état, pourri, qu’ils ont été obligés de changer ce cercueil. Le corps arrive en France en août 1951. Avant son inhumation définitive à Villeneuve-le-Roi dans le caveau de famille de Bracony-Doux, après tous ces rapports invraisemblables (…) de petits et hauts fonctionnaires, j’exige d’identifier ma femme moi-même accompagné de sa sœur aînée et de mon fidèle ami le commandant S. venu ce jour-là au cimetière de Pantin à l’ouverture du cercueil. Conformément aux règlements, j’ai rempli une fiche signalétique. Ses amies, en particulier Madame Y., m’avaient en détails expliqué tout de l’ensevelissement et de la mise en bière en 1940, etc. Dans la fiche signalétique, je spécifie trois choses capitales : 1) je joins une mèche de ses cheveux, je signale qu’elle s’était fait faire une indéfrisable très peu de temps avant son décès (elle pensait à Tamatave avoir de suite un bateau pour la ramener près de moi à Djibouti) ; 2) un grand crucifix était placé sur sa poitrine, placé par Madame Y. au moment de la fermeture du cercueil. Ce crucifix fut retiré brutalement par l’entrepreneur, franc-maçon et juif, et replacé d’autorité par Madame Y. 3) très important, un dessin représentant les mâchoires supérieures et inférieures, réclamant les détails de la dentition, ce que je fis très minutieusement en marquant sur le dessin le bridge supérieur, couronnes et dents en or. Ma femme avait son dentiste rue Dauphine à Paris et je connaissais bien sa dentition, ainsi que sa sœur aînée.
Convoqué en août 1951 au cimetière de Pantin pour l’identification, j’y suis donc avec sa sœur et mon ami le commandant S., retraité demeurant à Clichy. Le cercueil zingué intérieur est ouvert, dehors en plein jour par un beau soleil. C’est un grand drap blanc, fermé et torsé aux bouts, à la tête et aux pieds. Je vois le gros crucifix très bien placé au milieu sur la poitrine, sur le linceul il n’a pas bougé, il est resté immobile, en équilibre, pendant trente jours de bateau, de train, camions, etc. Le drap est détorsé à la tête et ouvert jusqu’au bassin. Sa sœur et moi reconnaissons formellement ma femme par ses cheveux ne tenant plus au crâne, les dimensions et formes du crâne, de la tête séparée du tronc, correspondant à la réalité. Avec des gants, la tête est enlevée, afin d’examiner de près la dentition. Le bridge, couronnes, dents, tout ce qui était en or a été volé. On cherche, on fouille, inutile : c’est volé. Le crucifix en bois, lui, n’a pas bougé en équilibre, dehors sur le drap ; alors pourquoi un bridge et autres, enveloppés dans le drap, auraient-ils bougé ?
Tout m’est revenu à la mémoire : la facilité d’entrer dans la salle mortuaire à Tananarive ; le souvenir de madame T. avec une pince arrachant le bridge à son mari mort exposé dans cette salle ; ma femme le lendemain de son décès, d’après ses amies, sa figure défaite, sa bouche de travers et saignante, etc. J’en conclu qu’il existe là-bas un ou des détrousseurs de cadavres. J’ai tout signalé en 1951 à monsieur le Gouverneur général de Madagascar, toutes les constatations lui ont été exposées avec les moindres détails en lui demandant de laisser en paix la mémoire de ma malheureuse femme et, s’il le peut, avec une police et des fonctionnaires honnêtes faire cesser de tels actes.
Madagascar
Madagascar est vichyste avec le gouverneur général M., mais bientôt tout va changer. Heureusement pour moi, car je suis assez bien renseigné par un bon camarade, suspect comme moi, qui m’apprend qu’en France nous serions déjà depuis longtemps prisonniers de la Gestapo.
Pour empêcher l’arrivée des Japonais, qui devait être imminente, les événements se précipitent. Les Britanniques s’emparent du nord de la Grande Isle en mai 1942, puis en septembre les Afrikanders débarquent à l’Est et à l’Ouest et, après trois mois de dures batailles, libèrent complètement Madagascar en faisant toute l’armée vichyste prisonnière et gardée par les Zoulous. Madagascar est ralliée aux Forces Françaises Libres, mais l’armée vichyste ne veut pas rallier De Gaulle. Alors arrive de Londres le colonel Bureau qui leur dit : « Il ne faut pas penser qu’à votre compte en banque, ni à la petite vie tranquille de bureau, il y a la France à libérer ». Très peu ont signé pour rallier les FFL, mais à la fin de chaque mois, quand ils voyaient qu’ils ne touchaient pas de solde, ils acceptaient de signer et rallier les FFL pour passer à la paie. Très peu se sont entêtés à ne pas signer et ils ont été conduits prisonniers au Kenya et au Cap.
J’ai demeuré deux ans et demi dans Madagascar, comme contremaître au Chemin de fer du TCE,23 aux ateliers et sur des chantiers en brousse sur la côte Est, à réparer les destructions des sauvages de vichystes, tel le pont de la carrière de Brickaville, etc.
En 1943, à Tananarive, j’écris ma demande aux FFL pour participer au premier débarquement en Italie. Cette demande est refusée. Alors j’en écrit une deuxième qui est aussi refusée par le sous-secrétaire du général Le Gentilhomme. J’ai été trouver ce haut fonctionnaire dans son bureau à la résidence pour connaître le motif de ce refus. Il m’expliqua qu’il y avait peu d’hommes sincères à Madagascar sur lesquels il pouvait avoir confiance et que ma place était avec lui pour surveiller les traîtres, leur imposer silence, que je rendais de bons services à la colonie. (Je me souvins alors des certificats des toubibs charlatans de Dakar de 1936 ; en 1936, pour eux, j’étais inapte. Comme l’on change ! À présent je suis un homme de confiance pour les FFL !)
Je repars vers des chantiers à la côte Est qui est insalubre. Mes équipes d’ouvriers Malgaches sont de braves pères de famille, courageux. Je les ai choisis aux ateliers de Tananarive. Sur les chantiers, ils sont mal traités par l’ingénieur, monsieur D. Ces malheureux viennent se plaindre à moi en me montrant les marques des coups de canne qu’ils recevaient en bout dans le dos, dans les reins, partout. Moi et monsieur D. étaient les deux seuls Européens. Il était mon supérieur et je ne pouvais rien lui dire. Quand il est parti quelques jours, les travaux étant avancés, j’ai fait remonter à Tananarive toute mon équipe afin de leur épargner les coups de l’ingénieur D. quand il reviendrait. Il m’a reproché d’être trop bon avec ces gens-là. Ils travaillaient dur, par tous les temps, même sous la pluie. C’étaient de bons ouvriers, très courageux, très dévoués. Je ne comprenais pas les brutalités de monsieur D. C’était en 1943 et ce malheureux a payé de sa vie ; j’ai appris qu’il a été assassiné en 1948 lors de la révolution.
Je remonte à Tananarive avec les fièvres paludéennes. À six heures du matin, le thermomètre marque plus de quarante et un degrés. Le prêtre était là et tout le monde voyait ma fin. Je n’avais pas confiance aux médecins Européens et c’est deux médecins Malgaches qui m’ont bien soigné. Après m’avoir guéri ils m’ont dit par eux j’étais considéré perdu, alors perdu pour perdu, ils ont risqué tout pour le tout en me faisant une piqûre de quinine de triple dose. C’est ce qui m’a sauvé, mais ajoutent-ils « c’est grâce que votre foie est en bon état pour supporter une telle dose, car si votre foie n’avait pas été en bon état, la bilieuse se serait déclarée et en quelques heures vous seriez mort ».
L’Hôpital colonial de Tananarive
Je me suis remarié pendant ce séjour à Madagascar avec une Créole Réunionnaise qui, elle aussi, va être victime de mauvais soins d’un commandant médecin-chirurgien militaire à l’Hôpital colonial de Tananarive. Il se nomme F. Je l’avais connu à Djibouti comme lieutenant-dentiste. Des camarades m’avaient parlé de ce citoyen qui, aux soirées de l’Odéon de Djibouti, allait chanter de l’opéra devant la Commission d’armistice italienne au profit des œuvres à Pétain. De triste mémoire…
Ma première femme est morte (…). Ma deuxième femme allait mourir (…) comme la première si je n’avais pas été là pour empêcher le pire. (…) Je tiens cependant à déclarer que j’ai connu aux colonies certains médecins capables, dévoués et honnêtes. Pour moi, le meilleur des meilleurs, ce fut le médecin-chirurgien S. (…)
Elle est née le 1er septembre 1914 à Tananarive d’une famille réunionnaise. Son père était receveur principal des Postes, décédé en 1941. Elle est orpheline de père et mère. Je l’ai épousé en 1942 à Tananarive. Elle avait vingt-huit ans et moi j’avais quarante-quatre ans. Elle a toujours été honnête, il n’y a rien à lui reprocher. Dès les premiers mois de notre union, elle a le désir d’avoir un enfant, mais elle n’obtient pas satisfaction à ce sujet. J’en fais part au commandant S., médecin-chirurgien, nouveau chef de l’Hôpital colonial de Tananarive. L’ex-médecin chef, colonel T., (…), vient d’être emmené prisonnier par les Britanniques et les Afrikanders. Il est remplacé avantageusement par le commandant S., docteur-chirurgien capable et honnête. Le docteur S. nous examine. Après l’acte naturel il prélève sur ma femme les spermes qui sont analysés par les soins du médecin capitaine T. qui déclare que monsieur Doux pourrait faire douze enfants d’un coup. Le docteur S. au second examen de ma femme conclut qu’après lui avoir fait subir un simple petit traitement qu’elle sera ensuite enceinte facilement certainement. Ce petit traitement dura un mois environ pour supprimer une légère inflammation due au mariage. Au bout d’un mois, toujours suivant ce que le docteur S. avait ordonné de faire cinq minutes avant le rapport, le résultat est acquis : elle est enceinte et nous sommes heureux.
Tous les mois, à l’Hôpital colonial, elle va devant le commandant S. passer la visite obstétrique. Tout est normal. Elle est très grosse et un jour de visite, croyant l’accouchement proche, le docteur la garde à l’hôpital. Il la voit tous les jours. Étant à l’hôpital, elle a accouché sept semaines après son entrée. Le commandant S. en plaisantant disait à ma femme : « C’est bien long à venir, ça va être un éléphant » ; mais il constate que tout va bien, il n’y a qu’à attendre. Moi, je suis tranquille, elle est dans des bonnes mains. Attendons l’événement heureux.
Le commandant médecin-chirurgien chef G., rugbyman, sportif, homme capable et consciencieux, se trouve fatigué, surmené et il doit partir se reposer quelques semaines vers Manakara. Avant son départ, il m’assure que tout doit bien se passer, que tout est normal. Il est remplacé par le galvaudeux, bon à rien, le commandant F.
≤≥
Un matin, par un coup de téléphone envoyé de l’Hôpital à la gare de Tananarive, je suis prévenu dans mon atelier du chemin de fer, d’aller à l’hôpital. Je suis heureux. Je prends un pousse-pousse, l’hôpital est loin et ça monte là-haut près du cimetière. Arrivé, je monte en vitesse au premier étage, traverse les galeries vitrées et, stupeur, les persiennes de la chambre de ma femme sont fermées et à sa porte un écriteau « Défense d’entrer ». J’entre et dans une demie obscurité j’aperçois un radiateur électrique sur une table, près du lit de ma femme, pour la chauffer. Elle me voit et dans un souffle que j’entends à peine, elle me dit : « Elle est morte et moi aussi, je vais mourir. »
Juste à cet instant, la sage-femme, madame L., arrive doucement près de moi, me prend le bras, m’emmène dehors de la chambre, me recommande le silence. J’interroge : « Que s’est-il passé ? » Réponse : « C’est un accident ; c’est pas le premier et, malheureusement, pas le dernier. » Je comprends mal cette réponse. Le docteur G. avant son départ était certain que tout irait bien. L’enfant fort paraissait âgé de deux mois, dix livres, de longs cheveux noirs comme sa mère, les membres et poitrine potelés. Un bébé superbe qui ne demandait qu’à vivre. Je vais interroger le docteur F. qui me répond en m’affirmant : « L’enfant est bien constitué ainsi que le placenta, mais c’est de la faute à votre femme, elle n’a pas poussé. J’ai été cinq ans à Diego Suarez et je connais ces femmes-là. Toutes ces femmes créoles sont pareilles. Elles geignent beaucoup mais elles ne forcent pas. » Je reviens près de la sage-femme qui me dit timidement : « C’est pas certain que votre femme soit sauvée. Il ne faut pas aller près d’elle. Il faut du silence et du calme. »
Je suis abasourdi. C’est défendu que j’approche ma femme, alors je pars au cimetière tout proche et sur la tombe de mon infortunée première défunte, je pense à toutes les années passées. Que va-t-il encore m’arriver ? Je repars pour mon atelier du chemin de fer. Je ne sais pas quoi expliquer aux amis et camarades qui me voient triste. Je souffre terriblement. Je la vois agonisante et mon enfant tuée.
Tous les soirs après mon travail, je vais voir ma femme qui a les deux jambes dans des gouttières (double phlébites), allongée immobile. Mais alors ma femme me parle. J’ai parlé aussi avec des femmes hospitalisées la nuit de l’accouchement de ma femme et j’ai appris ce qui s’est passé. Voici ce que j’apprends. « C’était affreux d’entendre crier votre femme, de vingt-trois heures à quatre heures du matin. Mais de deux heures à quatre heures, elle criait de moins en moins fort. »
Ma femme m’explique : « À vingt et une heures, j’ai senti les douleurs et la sage-femme m’a installée sur la table d’accouchement dans la salle près de ma chambre. Jusqu’à vingt-trois heures, elle venait me voir, puis à vingt-trois heures elle dit que la tête ne passe pas. Ça n’est pas prêt, ça sera pour demain matin et elle partit se coucher, me laissant seule sur cette table ». C’est justement là, à vingt-trois heures, que les douleurs furent très violentes jusqu’à deux heures du matin. Ensuite de moins en moins violentes jusqu’à quatre heures. Et de quatre heures à six heures, ma femme commençait à mourir avec l’enfant dans son ventre, morte et étranglée avec une double circulaire du cordon.
Le docteur F., remplaçant du médecin-chef G. n’était pas à son poste. La sage-femme dormait sans s’occuper que mon enfant et ma femme mourraient. Le docteur F., galvaudeux introuvable par téléphone en ville et partout, tout de même il arrive à l’hôpital à six heures vingt minutes. Il fonce vers ma femme et méchamment lui crie : « Taisez-vous ! Criez pas comme ça ! » Il revenait de faire la bombe toute la nuit et il n’était pas à jeun. Avec bistouri et forceps il sort mon enfant (…)
(…) mais attention je suis là. Cette fois je veille de près. Tous les matins de bonne heure avant mon travail et le soir après ma journée de travail, je cours près d’elle. Elle répond à toutes mes questions. Je me renseigne de tout.
≤≥
Trois semaines après l’accouchement, le brave docteur G., après son repos bien mérité – je connais son dévouement envers d’autres malades – reprend son poste de médecin-chef et passe visiter les malades. Ce premier jour, il est accompagné du docteur F. qui lui rend compte du travail fait et à suivre, etc.
Ma femme m’a expliqué cette première visite, les paroles et remarques sévères du docteur G. adressées au docteur F. Les deux docteurs entrent ensemble dans la chambre de un lit où se trouve ma femme. Ils se regardent tous les deux. Le docteur G. étonné, surpris, reconnait ma femme et questionne le commandant F. qui répond au commandant G. : « Ça va, c’est terminé, c’est fini, ça va bien à présent, dans trois ou quatre jours elle pourra sortir de l’hôpital et rentrer chez elle ». Le commandant G. retire les draps pour examiner ma femme des pieds à la tête. Ma femme prend peur et pleure. Le commandant G. la console paternellement, la réconforte, lui disant : « N’ayez pas peur, je ne vous ferai pas de mal » et avec ses mains, tire, palpe les jambes, les genoux et, s’adressant à l’incapable F. d’une voix et d’un ton de reproches, le commandant G. dit : « Comment, vous trouvez ça fini ! Mais regardez, c’est plein d’eau tout ça ! » et avec ses mains il tirait, poussait, faisant voir le mal au galvaudeux de F. qui ne répondait rien. Ils continuèrent plus loin, dans les autres chambres, à visiter les autres malades.
Quand ma femme me rapporta ces paroles du docteur G. à l’adresse du docteur F., mes soupçons étaient confirmés : F. était un incapable, un galvaudeux, un (…) intouchable. (…) tout ça sous la couverture d’un brave serviteur de la Nation qui attend les galons, la légion d’honneur et une belle retraite que je lui paierai plus tard. Sans le docteur G., la canaille de F. allait dans trois ou quatre jours sortir ma femme soi-disant guérie (comme moi en 1935 à Bamako par l’alcoolique commandant A. V.). Mais heureusement que F. n’a plus à s’occuper de ma femme, car dix jours après la fameuse visite des deux docteurs, il y a des complications : embolie au poumon gauche, puis infection pulmonaire au poumon droit. Si ma femme avait été sortie de l’hôpital par F., elle serait morte en route ou à la maison chez nous.
Pendant trois jours tout le monde connaît, sauf moi, que madame Doux à l’hôpital va mourir, qu’il n’y a guère d’espoir. Le docteur G. lui fait des piqûres d’huile camphrée morphinée pour résorber les caillots qui sont près de son cœur. Je suis angoissé par l’allure des gens qui sont là. Un d’eux me dit : « Ah ! Mon pauvre monsieur Doux ! » Je ne veux pas comprendre et je vais voir le bon docteur G. et lui dit : « Docteur, ne me cachez rien. Dites-moi la vérité » et il me répond : « Vous êtes un homme, soyez courageux ». Le ton me faisait tout comprendre. Elle était condamnée à moins d’un miracle.
≤≥
Parmi les connaissances et fréquentations que j’avais dans Madagascar, loin, dans les faubourgs de Tananarive, à Issoutra, dans les sentiers, j’avais un vieil ami à qui je rendais assez souvent visite, car il ne se déplaçait que très rarement. C’était Papa Léon, orpailleur très riche, aimé, vénéré et craint de toutes les races, même des Européens. Il avait en 1943 quatre-vingt-quatre ans, très grand, valide, marchant droit sans canne, noir ébène, cheveux et moustaches crépus tout blanc. Il était le plus fort sorcier de Madagascar, magicien blanc, guérisseur incontesté. Autrefois, il avait reçu des récompenses du général Gallieni24 pour lui avoir guéri une plaie incurable à la jambe. Ce vieillard calme me donnait toujours de bons conseils, m’apprenait mille choses et il était heureux, ainsi que moi, de parler longuement ensemble.
Désespéré, je quitte le docteur G. de l’hôpital, je cours chez Papa Léon à Issoutra. Je le mis au courant de tout. Je le suppliais de sauver ma femme. Il me dit : « Allez me chercher un pousse-pousse, c’est loin l’hôpital et j’y vais avec vous ». Au premier étage à l’hôpital, dans les galeries, dans la chambre de ma femme, partout où se trouvaient des infirmières Malgaches, ça se vidait aussitôt à la vue de Papa Léon ; elles se sauvaient se cacher et ne réapparaissaient plus. J’ignore pour quel motif. J’avais prévenu ma femme que je lui ferais connaître Papa Léon, qu’il était brave et viendrait la soulager avec des prières.
Papa Léon m’ordonna de le laisser seul dans la chambre avec ma femme. Ils restèrent une heure seuls enfermés, et il sortit en me disant : « Votre femme ne mourra pas. » Je l’ai reconduit à Issoutra et suis revenu près de ma femme. Elle dormait, il était tard. Le lendemain matin de bonne heure, je vais au lit de ma femme et la questionne doucement. Papa Léon avait fait des prières, des incantations et il avait brûlé des encens, semé des sels bénis partout, passé des gros sels bénis sur les jambes de ma femme, sur sa tête. Il priait à haute voix en langage qu’elle ne comprend pas.
Ainsi au bout de cinq mois d’hôpital, après les bons soins du docteur G. et peut-être un miracle de Papa Léon, ma femme sort, portée sur un brancard. Elle ne marchait plus et longtemps je lui apprends à marcher en s’appuyant sur deux dossiers de chaises, une de chaque côté. Depuis ce temps, c’est une jeune femme estropiée pour sa vie, sa santé fragile, faible et toujours fatiguée. Elle souffre, c’est une rescapée. (…)
Djibouti – Rappel des Chemins de Fer franco-éthiopiens
En mai 1944, ma Compagnie du Chemin de fer franco-éthiopien me rappelle d’urgence et à Tamatave j’embarque avec ma femme à bord du Meonia, paquebot danois de luxe, mais armé. Je dois rejoindre Djibouti. Pendant la traversée, j’ai encore un fort accès de palu. L’oreille droite se met à couler. J’en souffre. Le médecin du bord a du mal à arrêter cet écoulement. C’est au Kenya, à Mombassa, qu’il a trouvé le médicament pour bien me soigner. En quittant Mombassa, notre bateau fait route vers Aden, dans un convoi formidable de transports de troupes britanniques coloniales, bateaux de guerre, avions, etc. Ils vont continuer jusqu’en Europe pour la Libération.
J’arrive avec ma femme à Djibouti, Somalie française, mais j’ai trop souffert d’un séjour colonial trop long, de 1938 à 1946 consécutif, huit ans, dans des conditions souvent mauvaises. En fin de 1945, je suis complètement anémié par les climats, les fièvres paludéennes. Je n’ai pas de nouvelles de France de mon avocat qui m’avait dit « Faites un séjour colonial de deux ans et je gagne facilement votre procès contre le gouvernement de l’AOF ». Je n’ai pas de nouvelles de ma famille. Je me sens diminué. Le blocus m’a marqué.
.jpg)
1944 –Djibouti, Syndiqué à la CGT en qualité de cheminot
.jpg)
Ma direction a eu une mauvaise conduite. Elle a collaboré avec l’Axe. Je fais partie du Comité de libération et d’épuration. A certains lâches, je reproche leur attitude. (…)

Comité d’action pour la Libération – Côte française des Somalis
Beaucoup d’agents anciens viennent de rentrer en France se reposer et sont remplacés par des nouveaux arrivés de France qui ne connaissent rien des colonies. Ils ne connaissent que le marché noir. Ma direction d’accord avec le gouverneur embauche des fascistes « prisonniers italiens libres ». Il y en a de logé à côté de mon logement. Ils ont plus de confort que des Français, une belle solde et tous les soirs, tard, ils jouent de la musique à me casser les oreilles.
Un soir, je me fâche et je rentre chez mon voisin mitoyen avec une trique. Il se nomme R., colosse aux épaules carrées. Comme tous les Italiens courageux, il se sauve. Sa concubine indigène était restée couchée sur un divan sans que je fasse attention à elle. À coups de matraque j’ai tout cassé : ventilateurs, plafonniers Marelli, portatif, phono, mandoline, guitare, table de toilette avec toutes les photos et images mondaines, miroirs, fauteuils, table, clôture de la galerie, etc., etc.
Tous les vrais Français, nous avions demandé plusieurs fois et insisté pour le renvoi de ces fascistes Italiens indésirables, mais notre direction et gouverneur se moquent de nous et gardent ces joueurs de guitare. Justice, gendarmerie, police, etc., tout ça nouveaux arrivés de Martinique, Madagascar, Afrique du Nord où planqués ils n’avaient souffert de rien ou plus ou moins collaboré avec Vichy, me tombent dessus.
Je suis arrêté par le gendarme D. nouveau arrivé d’Algérie, jeté en prison pendant trois mois par plus de quarante-cinq degrés à l’ombre. Je suis jugé. Écœuré, je ne veux pas me défendre. Ces gens sont répugnants. Je suis condamné à six mois de prison avec sursis. Au lieu de renvoyer les Italiens fascistes, c’est moi, ancien combattant de 1914-1918, résistant aux lâches, qui est expulsé après avoir payé toute la casse au Macaroni fasciste. Licencié, je rentre définitivement en France en Janvier 1946 avec ma seconde femme et mon petit garçon âgé de cinq mois. En plein hiver, il attrape une bronchite en arrivant en France.
1946 – Rentré en France
Depuis janvier 1946, j’ai travaillé chez plusieurs patrons, principalement dans l’agencement et le bâtiment, wagons-lits, paquebots, installations générales de magasins, etc. J’ai milité au Parti communiste à la cellule Catelas25 à Choisy-le-Roi, mais trop fatigué j’ai tout abandonné en leur gardant toute ma sympathie sincère. Je suis membre de l’ARA (Association républicaine des anciens combattants) ; je suis syndiqué à la CGT et à la Mutuelle des métallos, 96, rue Jean-Pierre Timbaud à Paris.
En 1953, je suis copropriétaire de deux appartements que j’ai acheté à Choisy-le-Roi, à mon domicile, (…). Depuis que je suis copropriétaire, je n’ai que des tracasseries. Le propriétaire, un vieux Juif vénérable de la franc-maçonnerie, par des procédés malhonnêtes, arrive à tirer des profits sur les anciens appartements qu’il a vendus et ne lui appartiennent plus. Ceci semble invraisemblable et c’est absolument la vérité. Les jeunes copropriétaires, intimidés, pour avoir la paix, préfèrent payer ce qu’ils ne devraient pas payer. Et moi, avec mes trois gosses, je proteste. Je paie un gérant d’immeuble pour me défendre et le vieux Juif spéculateur est tenu en échec. Les autres copropriétaires profitent, car sans moi ce bandit de propriétaire, spéculateur, ne connaitrait aucune borne.
J’étais propriétaire d’un terrain de cinq-cents mètres carrés à Villeneuve-le-Roi, acheté en 1952. Tout seul j’avais fait un travail formidable. Les dimanches, fêtes, tous les soirs après ma journée de travail chez mon patron, j’avais posé une clôture de grillage de un mètre cinquante, planté dix-sept arbres fruitiers, tout en culture maraîchère. Pendant deux ans et demi j’avais construit moi-même en aggloméré que je gâchais et coulais en coffrage, une maisonnette de quatre petites pièces que j’espérais habiter dans mes vieux jours au grand air et dans le calme des champs. Mes enfants, plus grands auraient gardé les appartements de Choisy-le-Roi. Mais je suis né sous une mauvaise étoile sans doute, peut-être oui, peut-être non. En tous cas, après m’avoir donné tant de mal et de privations, je suis exproprié par une grande société riche qui va bâtir des logements pour les gens qui viennent gagner leur vie dans la région parisienne. Obligé de partir de mon pays natal pour faire place à d’autres.
Les gouvernements fascistes ou réactionnaires savent s’enrichir sur le dos des pauvres diables sans défense. En 1898 ma grand-mère paternelle m’avait placé mille francs en pièces d’or et en 1924, j’ai touché ces mille francs en papier et une valeur diminuée d’au moins dix fois.
Dans la main droite j’ai deux doigts atrophiés dans le travail, dans la main gauche un doigt arraché dans le travail. Mon bras gauche fracturé dans le travail ne fait plus de rotation. J’ai eu une fracture du bassin dans le travail. J’ai eu des maladies graves dans le travail. Par des procédés crapules, malhonnêtes, l’Administration partout m’a frustré de mes droits. Je n’ai aucune pension d’invalidité.
Tout ce que j’ai perdu en 1940, abandonné en Éthiopie (deux-cents mille francs d’affaires), sont inscrits dans un dossier au ministère des Affaires étrangères à Paris, 146, avenue Malakoff, XVIe, mais j’attends pour être indemnisé depuis longtemps. L’Italie n’a pas d’argent, c’est la France qui va nous rembourser nos pertes, mais nos gouvernements à moitié fascistes préfèrent secourir les fascistes Hongrois en 1956-1957 ou gaspiller les deniers publics en Corée, en Indochine, Port-Saïd et ailleurs. Tous les rètres26 et mercenaires sont grassement soldés. En 1914-1918, un Poilu pour cinq sous par jour, au front dans les tranchées, hiver ou été, en Orient ou aux Dardanelles ! Pourquoi aujourd’hui donner deux cent mille francs et plus à un Poilu qui est en Corée ou ailleurs. C’est prélevé sur le salaire des ouvriers.
Actuellement, je suis en traitement et au régime. Suite de la fracture du bassin en août 1935, j’ai une lésion à la colonne vertébrale dont je souffre énormément, surtout la nuit, et je n’arrête pas mon travail, j’ai trois jeunes enfants à élever.
Je touche tous les trois mois ma retraite d’ancien combattant de 14-18, trois cent dix-sept francs. Les réactionnaires qui gouvernent s’emplissent les poches sur le dos des honnêtes travailleurs, avec la complicité des spéculateurs et des voleurs. Le régime est pourri. De hauts fonctionnaires et parlementaires trempent dans les plus grands scandales et restent impunis comme les traîtres qui sont graciés et relèvent le nez. Affaire des Piastres, Bons d’Arras, affaires des vins, affaires des blés. Je ne peux tout citer. Aux colonies, c’est loin, ça se sait moins. (…)
J’ai eu toutes les occasions d’être un homme riche, d’avoir de grosses fortunes, mais j’ai toujours espéré voir la fin des régimes capitalistes pourris – qui ne tardera pas d’ailleurs – contrairement aux nouvelles générations gangrénées, je n’ai que dégoût et pitié pour les riches, la plupart pauvres d’esprit.
Ici s’achèvent les Mémoires d’un compagnon du devoir menuisier-ébéniste
Septembre/Octobre 1956
Lexique et commentaires
1) Déménager à la cloche bois : partir en laissant des dettes
2) Canard : argot, terme de mépris employé dans les ateliers et désignant un mauvais camarade
3) Manne : panier, fr. du XVIe s. resté en usage dans la marine
4) Ringard : tige de fer servant à attiser le feu, décrasser les grilles, retirer les scories ; pique-feu, tisonnier (réf. Encyclopédie Universelle)
5) Fourrier : sous-officier de la marine, responsable du personnel et du matériel
6) « A la coupée » ou « à la coupe » : passerelle servant aux escales
7) Saco : fusilier marin ; sur un bateau on dit qu'ils sont les fils du bidel, et de façon plus péjorative des plantes vertes, de la couleur de leur tenue de combat qu'ils ne quittent jamais (réf. Dico Mataf) https://passion.marine.pagesperso-orange.fr/dico_mataf.htm#lettre_s
8) École Boulle, Paris : du nom du célèbre ébéniste de Louis XIV ; école d’arts et métiers, fondée en 1886 ; on y enseigne les métiers d’art (ébénisterie, marqueterie, tapisserie, sculpture sur bois ou sur pierre, coulage des statues de bronze, etc.)
9) Lénine logeait alors avec sa famille au 4, rue Marie Rose à Paris XIVe ; le lieu devint plus tard musée, le Musée Lénine, jusqu’en 2007 où il ferma ses portes.
10) Laptot : en usage au Soudan pour désigner l’extracteur de sable fluvial (du Niger)
11) Par protection : par faveur, ‘piston’
12) Mousso : en bambara, femme
13) Lazaret : établissement de mise en quarantaine des passagers, équipages et marchandises en provenance de ports où sévissait la peste ; plus tard, ces établissements seront reconvertis pour recevoir les épidémiques (réf. Wikipédia). Toutefois, le lazaret du Cap Manuel à Dakar (Sénégal) était également un asile psychiatrique.
14) Livrer le chiffre : avoir permis le décodage en livrant à l’ennemi les codes secrets
15) Bristol Blenheim : bombardier léger rapide et triplace utilisé par les Britanniques durant la Seconde guerre mondiale
16) Henry de Monfreid, qui a connu le Blocus, dans son ouvrage sur le Blocus de Djibouti, Le Radeau de la Méduse ou comment fut sauvé Djibouti, mentionne également ces faits (les Tirailleurs recevaient une petite portion de nourriture supplémentaire), ajoutant que les autorités sanitaires avaient pris l’initiative, inhabituelle pour les états de siège, d’ouvrir un restaurant de fortune où les habitants, Autochtones, Tirailleurs ou Européens, après avoir été dûment pesés et examinés, pouvaient se restaurer régulièrement jusqu’à ce que leur poids leur permette de survivre.
17) L’amiral Platon fut un proche de Pétain (réf. Wikipédia :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Platon )
18) Boutre : marine ; voilier arabe (réf. le-dictionnaire.com)
19) Les circonstances de l’exécution de Roger Donnard ont fait l’objet de plusieurs récits. Pour Monfreid, Donnard n’est que le tenancier de La Brise de mer, nom du lupanar de Djibouti où fut préparée l’évasion de plusieurs gradés de la Coloniale pour rejoindre les FFL. Autre récit, autres termes, celui d’un Américain rallié aux FFL, Hassoldt Davis, auteur de Feu d’Afrique ; le lupanar n’y est plus qu’une « petite maison de femmes », quand la mémoire de Donnard y restera à jamais « tout l’honneur de Djibouti ». Sur un autre plan, un camarade de Roger Donnard fut arrêté en même temps que celui-ci, mais échappa à l'exécution (réf. P. A. Doux).
20) Gueuse : lingot de fonte
21) Zoma : en malgache, marché
22) Quinacrine : Au début du 20e siècle et pendant la Seconde Guerre mondiale, on l'administrait pour prévenir le paludisme (réf. Wikipédia)
23) TCE (Tananarive-Côte Est), Chemin de fer de Madagascar
24) Le gral Gallieni fut gouverneur général de Madagascar de 1896 à 1905
25) Jean Catelas : personnalité politique, membre du Parti Communiste, exécuté en 1941, en représailles à l’assassinat par le col. Fabien d’un officier de la Kriegsmarine
26) Rètre : au sens figuré, homme que l’on assimile à un soudard, à un vieux soldat
Annexe
Diré-Daoua, le 02-09-1938
Je soussigné Mr Doux Pierre, André, Chef ouvrier d’entretien à la Compagnie du C.F.E. autorise ma femme, Mme Doux, Albertine, Jeanne, Gabrielle,* née Simon, née le 16 décembre 1902 à Choisy-le-Roi (Seine), fille de (…) et de (…) à me rejoindre à Diré-Daoua, Ethiopie, (AOI).
*prénom d'usage
________
Diré-Daoua, le 22 septembre 1938
Monsieur le Chef de Service du Matériel et Traction
Je soussigné Doux Pierre, chef-ouvrier d’entretien au wagonnage de Diré-Daoua, m’engage de rembourser le montant des frais de passage de ma femme dans le cas où je voudrais quitter la Compagnie du CFE de mon plein gré, avant d’être classé dans les Cadres à l’expiration de mon stage prévu au règlement général, article 3.
________
Diré-Daoua, le 6 octobre 1938
Matériel et Traction
Monsieur le Chef de Service,
J’ai l’honneur de solliciter de votre bienveillance de bien vouloir me faire obtenir quelques jours disponibles afin d’aller chercher ma femme sur le bateau à Djibouti le jour de son arrivée, de même qu’un billet de Diré-Daoua/Djibouti/Diré-Daoua et un aller de Djibouti/Diré-Daoua pour ma femme.
Veuillez agréer, Monsieur le Chef de Service, avec mes remerciements, mes sentiments dévoués et respectueux.
Doux Pierre, chef ouvrier entretien, échelle 5, échelon 1
(Transmis à Monsieur l’adjoint au Chef de Service Matériel et Traction)
____
Diré-Daoua, le 1er/11/38
Matériel et Traction
Monsieur le Chef de Service,
J’ai l’honneur de solliciter de votre bienveillance de bien vouloir m’accorder 1 jour de permission, ainsi qu’un permis de circulation de Diré-Daoua/Djibouti/Diré-Daoua pour moi, valable pour le 10 novembre au soir, jusqu’au 12/11/38, allant chercher ma femme arrivant à Djibouti le 12 novembre par Le Dartagnan. Veuillez me faire obtenir également un permis de circulation pour ma femme de Djibouti à Diré-Daoua pour le 12/11/38, avec une réquisition de transport pour 100 kilos de bagages environ.
Dans l’attente que ma demande aura une suite favorable, veuillez agréer, Monsieur le Chef de Service, l’expression de mes sentiments dévoués.
_____
Diré-Daoua, le 5-11-38
Matériel et Traction
Monsieur le Chef de Service,
J’ai l’honneur de porter à votre connaissance, suivant les meubles que j’ai actuellement : 1 table ordinaire sans tiroir – 1 armoire – 1 broc – 1 pot à eau – 1 seau hygiénique – 1 cuvette – 1 table de toilette – 2 chaises – 1 lit à deux places – 1 matelas – 1 traversin – 1 moustiquaire – 1 garde-manger.
Voudriez-vous bien, Monsieur le Chef de Service, me faire obtenir en plus de ces meubles cités : 1 armoire – 2 chaises – 1 table – 1 buffet – 1 table de cuisine – 2 oreillers et 3 rideaux d’abou-djedid, ainsi que de me faire reblanchir mes 2 pièces.
En vous remerciant, veuillez agréer, Monsieur le Chef de Service, l’expression de mes sentiments dévoués.
(Transmis à Monsieur l’adjoint au Chef de Service Matériel et Traction)
_____
Août 1938 – Outillage courant d’un ouvrier menuisier travaillant à l’établi
1 paire d’affûtage (varlope et riflard avec fers et contre-fers de rechange)
2 rabots (un à dégrossir et un à raplanir avec fer et contre-fer de rechange
1 guillaume de fil (avec fers de rechange)
1 guillaume de bout
1 ciseau à bois de 55 ou 50 millimètres de largeur, aux champs biseautés
idem 35 mm id.
id. 20 mm id.
id. 15 mm id.
id. 10 mm id.
id. 5 mm id.
1 gouge à bois de 35 mm de largeur
20
15
10
5
1 vilebrequin à criquet
1 jeu complet de mèches américaine
1 jeu complet de vrilles
3 fraises à bois (une grosse, une moyenne, une petite)
2 frais pour métaux (une grosse et une moyenne)
1 mèche pour vilebrequin
1 chignole avec des forêts de tous diamètres
1 bec d’âne de 20 mm
14
10
8
6
4
1 rappe fine demi-ronde de 50 mm de largeur
id. 30
id. 20
1 rappe fine, plate
1 lime à bois demi-ronde de 40 mm de largeur
id. plate 20 id.
id. carrée 10 id.
1 queue de rat (rappe fine) de 20 mm de diamètre
id. id. 10 id.
1 queue de rat (lime à bois) de 12 millimètres de diamètre
id. (lime à fer) id.
1 fer de racloir à parquet
3 racloirs
1 raclette (Stanley) avec fers de rechange
1 rabot américain cintré
1 grand rabot américain (Stanley) pour la boîte à recaller
1 boîte à recaller (en charme si possible)
1 grande scie Sterling pour la boîte à recaller
1 scie Sterling de 0,25 m
1 jeu complet de lames de scie égoïne avec la poignée mobile à visse de serrage à oreille
1 scie pivotante à arraser
1 scie dite de ville
1 scie à tenon
1 chasse clous moyen, 1 pour pointes fines
Tiers-point pour affûter les scies (marque Fournier de préférence)
4 presses en fer pour ébéniste
4 serre-joints en fer de 1,40 m (pattes en fer coulissantes sur crans)
2 trusquins
1 compas en acier à pointes sèches de 0,20 m
id. à crayon de 0,20 m (pour traîner)
1 cordeau, un plomb au niveau d’eau
1 sauterelle (dite fausse équerre) de 0,25 m
1 équerre (rivée et renforcée) de 0,20 m x 0,15
2 chasse-pointes (un moyen et un très fin)
1 sangsue de 0, 15 m (pour visses romaines ordinaires)
1 marteau de 30 mm (dit marteau de menuisier)
1 paire de tenailles de 0,20 m
1 pince universelle de 0,15 m (dite pince d’électricien)
1 pince à voie (pour donner le passage régulier aux dents de scie)
Matériel d’affûtage indispensable pour les fers de raboteuse et dégauchisseuse
- Meule émeri spéciale avec la presse sur chariot coulissant
- Meule émeri pour confection de fers de toupie
- Tringles d’acier doux (spécial pour fers de toupie) de toutes les largeurs existantes
- Scies à ruban ordinaire
_____
Diré-Daoua, le 30 juillet 1939
Service Matériel et Traction
Monsieur le chef de Service,
J’ai l’honneur de porter à votre connaissance les faits suivants : samedi 29 juillet 1939 à 11 h 15 pendant la séance de travail, l’ouvrier ajusteur B. no – travaillant au wagonnage est venu me déranger de mon travail en m’accusant grossièrement de lui avoir dérobé un morceau de bois sur son établi.
Je répondis calmement que je ne lui avais pris aucun morceau de bois, que je n’avais nullement à perdre mon temps à discuter avec lui, que s’il avait à réclamer quelques choses qu’il s’adresse au chef du wagonnage (Mr D.)
A cela il me répondit avec un air menaçant et insolent qu’il allait me casser la gueule.
Les paroles menaçantes furent prononcées plusieurs fois par devant l’ouvrier menuisier R. travaillant avec moi et devant tous les indigènes se trouvant sur le lieu.
Je prévins Mr H. et Mr F. à qui j’avais demandé l’autorisation de récupérer 2 pièces de bois dans 2 pieds de vieux tréteaux cassés apportés de l’atelier par Mr S.
B. se rendit compte à la fin qu’il avait commis une erreur (que ce bois n’était pas celui qu’il avait pensé). J’ignore donc si ce n’était pas une provocation plutôt qu’une erreur volontaire de sa part. Car plusieurs fois cet ouvrier a tenté de me provoquer.
Veuillez, Mr le chef de Service, prendre les mesures nécessaires afin que cela ne se reproduise pas.
Daignez, Mr le chef de Service, agréer mes sentiments dévoués et respectueux.
_____
Requête au Commandant de Cercle de Djibouti
Comme suite au télégramme du Gouverneur général de Madagascar que vous avez bien voulu me communiquer ce jour concernant les familles du CFE évacuées de Djibouti à Madagascar, j’ai l’honneur de vous informer que je ne sollicite pas l’allocation militaire de (illisible) par jour.
_____
En plein blocus…
Compagnie du Chemin de fer franco-éthiopien de Djibouti à Addis-Abeba
Djibouti, le 12 décembre 1941
p. le Directeur de l’exploitation et (illisible)
Tananarive, le 11 novembre 1942
Le Chef-ouvrier Doux du Service M. T. est autorisé dans la limite des places assises prévues, soit maximum Six par banquette, si des places sont laissées disponibles par les agents admis officiellement au restaurant municipal, au profit desquels le service est organisé et par utilisation de l’intervalle entre les deux banquettes avec interdiction absolue d’utiliser la partie arrière de la plateforme.
- A utilisé la camionnette de la Compagnie pour descendre en ville prendre son déjeuner
_____